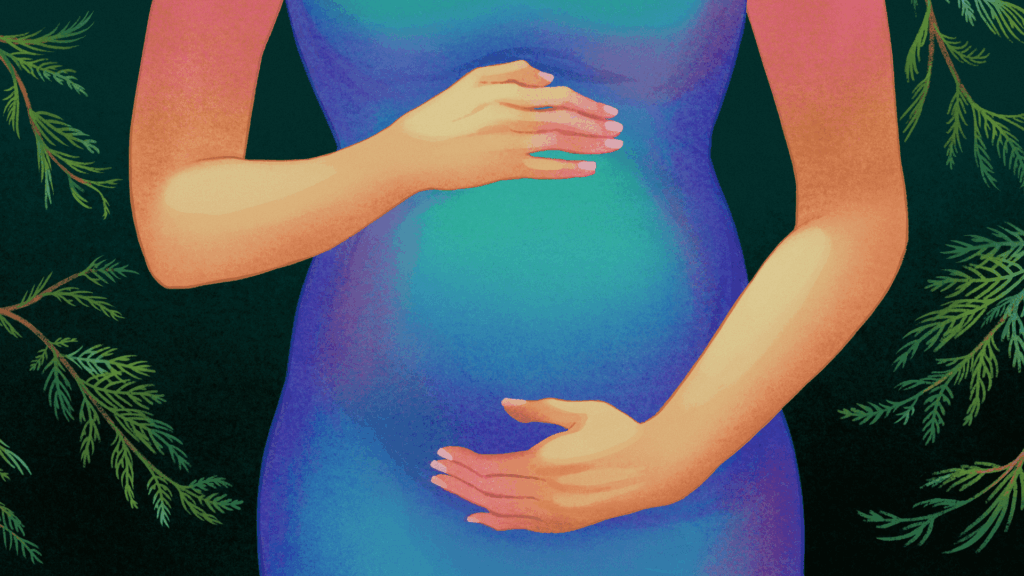Ce billet de blogue présente une analyse de la littérature actuelle sur la santé mentale périnatale autochtone, explorant les thèmes clés, les lacunes et les idées émergentes. S’appuyant à la fois sur des sources académiques et des perspectives issues de la communauté, cette analyse est enrichie par les voix des dirigeants d’associations menées par des Autochtones, qui offrent un contexte, une critique et un ancrage culturel essentiels. Leurs commentaires permettent non seulement d’approfondir notre compréhension de l’interaction complexe entre la santé mentale périnatale et les expériences autochtones, mais aussi d’affirmer l’importance du leadership autochtone dans l’élaboration de soins adaptés et culturellement sûrs.
Les lacunes de la recherche : Pourquoi n’en parlons-nous pas?
Lorsque j’ai commencé à faire des recherches sur ce sujet, j’ai été frappée par le peu d’informations disponibles sur la santé mentale périnatale chez les populations autochtones. Le manque de données est révélateur; cette question a été négligée pendant trop longtemps. Un examen systématique de 2020 publié dans la Revue canadienne de psychiatrie par Sawayra Owais et ses collègues a révélé que les femmes autochtones sont presque deux fois plus susceptibles de souffrir de dépression post-partum que les femmes non autochtones, avec des taux de prévalence atteignant 31 %. Malgré cela, les soins sécuritaires sur le plan culturel demeurent rares, ce qui oblige les femmes autochtones à mener leur combat seules, souvent dans le silence.
Ce silence ne relève pas d’un choix, mais plutôt d’un symptôme d’un système qui a longtemps laissé tomber les mères autochtones. La santé mentale post-partum, essentielle au bien-être de la mère et de l’enfant, continue de se heurter à de nombreux obstacles.
Si bon nombre d’études s’intéressent aux obstacles généraux à l’accès aux soins de santé maternelle, très peu explorent pourtant le fardeau émotionnel que ces difficultés représentent. Une étude réalisée en 2022 par Zarish Jawad, Nikita Chugh et Karina Daddar a révélé que les services de santé mentale périnatale destinés aux mères autochtones sont souvent inaccessibles, sous-financés et culturellement inadaptés, ce qui rend encore plus difficile pour les femmes d’obtenir le soutien dont elles ont besoin.
Un héritage de méfiance
Pour bien comprendre la réticence des mères autochtones à recourir aux soins de santé mentale périnatale, il convient de reconnaître la méfiance profondément ancrée envers le système de santé canadien. Depuis des générations, les familles autochtones sont soumises à des politiques qui rompent le lien entre parents et enfants, ce qui rend difficile la confiance envers les institutions censées leur venir en aide. Les établissements de santé n’ont jamais vraiment été des lieux de guérison pour les Autochtones.
Robin Smoker-Peters, professeure en santé autochtone à l’Université Western, confirme cette réalité : « Il ne s’agit pas seulement d’événements passés. Le dernier pensionnat indien au Canada a fermé ses portes en 1996, et des cas de stérilisation forcée ont encore été signalés il y a quelques années. C’est une réalité qui n’appartient pas seulement au passé, mais qui continue d’influencer la façon dont les Autochtones perçoivent les soins de santé. »
Même aujourd’hui, les mères autochtones craignent que le fait de demander des soins de santé mentale périnatale n’entraîne l’intervention des services de protection de l’enfance. Selon le recensement de 2021, les enfants autochtones représentent 53,8 % des enfants placés en famille d’accueil, alors qu’ils ne constituent que 7,7 % de la population infantile totale du Canada. Les familles sont déchirées en raison de préjugés systémiques et non de préoccupations réelles concernant la capacité parentale.
Une politique gravement préjudiciable qui a renforcé cette crainte a été le système d’alerte à la naissance, qui signalait les mères autochtones comme des cas préoccupants pour la protection de l’enfance, souvent sur la seule base de leur lien avec des survivants des pensionnats. Comme l’explique Robin Smoker-Peters, ce système reposait sur l’hypothèse que les mères autochtones étaient incapables d’élever leurs enfants, ce qui amenait à retirer les nouveau-nés à leur mère sans motif valable. Bien que ce système soit désormais interdit en Colombie-Britannique, de nombreuses femmes autochtones hésitent encore à demander une aide post-partum.
Un profond fossé
Les cadres occidentaux de soins de santé mentale périnatale ne fournissent pas le soutien culturellement adapté dont les mères autochtones ont besoin. Une étude réalisée en 2023 par Christina DeRoche et ses collègues a révélé que les professionnels de la périnatalité interrogés considéraient que les soins adaptés à la culture des parents autochtones faisaient défaut.
Un fournisseur a déclaré : « N’oubliez pas les soins de santé mentale périnatale autochtones, car ces personnes nous sont confiées pour des soins obstétricaux, mais nous ne savons pas quoi faire après le diagnostic », reflétant ainsi un système dépourvu de protocoles de soins clarifiés et pertinents sur le plan culturel. Un autre a souligné « l’absence de services destinés expressément aux Autochtones pour les troubles de l’humeur périnatale ». Même les fournisseurs reconnaissent leur capacité limitée à offrir des soins adaptés à la culture, mais ces failles perdureront tant qu’il n’y aura pas de changement à l’échelle politique.
Trouver des solutions aux problèmes de santé mentale périnatale chez les Autochtones ne se limite pas à reconnaître les inégalités; cela nécessite des mesures axées sur les perspectives autochtones, les méthodes de guérison traditionnelles et des soins sécuritaires sur le plan culturel. Robin Smoker-Peters insiste sur ce point : « On accorde trop d’importance aux traumatismes intergénérationnels et on ne prête pas suffisamment attention au racisme et aux préjudices qui caractérisent encore le système. Les mères autochtones ne devraient pas être considérées comme déficientes. Elles font preuve d’une force et d’une résilience immenses, et le système doit le reconnaître. »
Des solutions dirigées par les Autochtones : la voie à suivre
Malgré ces obstacles, les sages-femmes autochtones et les programmes de santé communautaires s’efforcent de combler ces lacunes. Le National Indigenous Council of Midwives (NICM) milite en faveur de soins maternels prodigués par des Autochtones, qui respectent le savoir traditionnel tout en intégrant la médecine moderne.
Lors d’une réunion du Sénat canadien en mars 2024, Claire Dion-Fletcher, ancienne coprésidente du NICM, a attiré l’attention sur les problèmes systémiques auxquels les femmes autochtones sont confrontées dans les établissements de soins de santé : « Je comprends que les médecins et les professionnels des soins ont des compétences spécifiques en matière de santé et de médecine. Cependant, il est également important de reconnaître que les Autochtones et les femmes autochtones possèdent une expertise approfondie concernant leur propre corps. Lorsque nous, en tant que fournisseurs de soins de santé, affirmons continuellement ce que nous pensons être le mieux pour les Autochtones, nous les privons de leur capacité à s’exprimer quant à ce qui leur convient en matière de soins de santé et à prendre des décisions les concernant. »
Les sages-femmes autochtones jouent un rôle essentiel pour garantir que les soins de santé reproductive respectent l’autonomie et le consentement éclairé. Ellen Blais, directrice générale du NICM, déclare : « Nous faisons de la prévention en appliquant les principes du consentement libre, préalable et éclairé, de la continuité des soins, des pratiques culturelles et de la défense des droits des patients. »
Ce témoignage met en lumière le rôle crucial que jouent les sages-femmes autochtones dans l’administration des soins, mais aussi dans la défense des droits et de la dignité des femmes autochtones.
L’intégration des sages-femmes autochtones dans les modèles de soins périnataux représente bien plus qu’une simple amélioration des services de santé; c’est un pas de plus vers la réconciliation. En soutenant les soins maternels dispensés par des Autochtones, nous créons un système dans lequel les mères autochtones se sentent en sécurité, respectées et autonomes tout au long de leur parcours périnatal.
Le projet Bringing Birth Home (Accoucher chez soi) est une initiative d’envergure qui vise à rétablir les services de sages-femmes autochtones et à encadrer les accouchements à domicile, réduisant ainsi les déplacements sur de longues distances. Tel que souligné dans l’article de l’Association des sages-femmes de l’Ontario intitulé « Bringing Birth Home: Restoring Indigenous midwifery (en anglais seulement) », chaque collectivité autochtone avait autrefois sa propre sage-femme qui offrait des soins complets, mais les politiques coloniales ont perturbé ces traditions. Cette initiative vise à rétablir les pratiques des sages-femmes et à maintenir l’accouchement au sein de la collectivité.
Qu’est-ce qui doit changer?
Dans un premier temps, il faut que les programmes de soins de santé mentale périnatale dirigés par des Autochtones reçoivent plus de financement et de soutien de la part de notre gouvernement. Des organisations s’y emploient déjà, mais elles ont besoin de ressources pour élargir leur rayonnement.
Il y a aussi la question de la représentation. Les femmes autochtones méritent d’être représentées parmi leurs soignants, mais il y a une pénurie de professionnels de la santé autochtones. Claire Dion-Fletcher explique qu’une approche autochtone « serait ancrée dans les relations et axée sur la prévention, et [elle] estime que l’un des principaux moyens d’y parvenir est de faire appel à des fournisseurs de soins de santé autochtones, des sages-femmes autochtones, des médecins autochtones, du personnel infirmier et des accompagnateurs de patients qui sont là pour promouvoir l’autonomie ». Inciter les étudiants autochtones à se lancer dans ces domaines, offrir des bourses et veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé non autochtones reçoivent une formation en sécurité culturelle sont autant de mesures qui vont dans la bonne direction.
Il est temps d’écouter
Pendant trop longtemps, les mères autochtones ont été exclues des discussions qui déterminent leurs soins de santé mentale périnatale. Les obstacles auxquels elles sont confrontées dépassent le simple problème de l’accès : ils sont profondément enracinés dans l’histoire, la confiance et le droit à des soins de santé respectant leur identité.
Or, les solutions existent déjà. Les sages-femmes et les travailleurs de la santé communautaire autochtones offrent un soutien efficace et respectueux de la culture. Si nous voulons véritablement améliorer la santé maternelle des familles autochtones, les décideurs politiques doivent mieux intégrer et inclure les perspectives autochtones. Cela implique de financer des programmes dirigés par les collectivités autochtones, de renforcer leur représentation et de veiller à ce que le fait de demander de l’aide soit considéré comme un droit et non comme un risque.
Dans notre démarche de promotion du changement, il est essentiel de reconnaître le passé et de respecter les droits des peuples autochtones, trop souvent négligés par le passé. Après tout, il ne s’agit pas seulement de politiques, mais aussi de vies humaines.
Je reconnais que le territoire sur lequel cet article a été rédigé et fait l’objet de recherches appartient à la Nation algonquine Anishinaabe, qui ne l’a ni cédé ni abandonné.