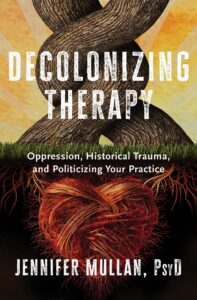Subscribe to Catalyst
Subscribe to get our magazine delivered right to your inbox
Related Articles
Rédiger son histoire en fin de vie a des effets thérapeutiques.
Coutume plus que centenaire, la notice nécrologique, ou obituary, en anglais, est l’avis écrit qui annonce la mort d’une personne et fournit quelques détails biographiques.
Selon le dictionnaire Merriam-Webster, le mot anglais obituary, du latin médiéval obituarius qui signifie sombre, voire menaçant, aurait été utilisé pour la première fois en 1703. Le français dispose du mot « obituaire », mais lui préfère le terme « notice nécrologique » ou « nécrologie ». Ce dernier, d’origine grecque, signifie « discours relatif à la mort », et son emploi date de la même époque, selon le Robert. Depuis le 18e siècle, il est d’usage qu’un membre de la famille ou un ami rédige cette notice. Ce n’est jamais une partie de plaisir ni une tâche à prendre à la légère, mais le rituel est devenu si habituel qu’il existe même des ouvrages qui recensent les meilleures notices. Certaines organisations préparent à l’avance la notice des personnages célèbres, l’industrie funéraire fournit conseils et modèles, et des prête-plume peuvent l’écrire pour vous. Mais un nombre croissant de personnes écrivent leur propre notice nécrologique.
Certaines de ces « autonotices », irrévérencieuses, avouant candidement un certain nombre de défauts, de conflits familiaux ou des problèmes de santé mentale, font sourire des gens qui ne connaissaient pas du tout la personne défunte et deviennent virales. C’est ainsi que la composition d’Angus Macdonald, de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, figure maintenant à la rubrique des notices comiques sur le site Legacy.com, pour son humour et son caractère poignant. Dans ce texte qu’il a rédigé avant sa mort à l’âge de 67 ans, en 2016, ce monsieur a écrit : « Je pense avoir été un chic type, malgré mes antécédents punk et en dépit de ce que certaines et certains diront de moi. Que savent-ils de moi, de toute façon? J’ai aimé ma famille et j’en ai pris soin dans les bons moments comme dans les mauvais. J’ai fait de mon mieux. »
À l’approche de la mort, certains « autobiographes » veulent tirer les choses au clair, régler des comptes ou réconforter leurs proches avec honnêteté, humour et courage, y voyant peut-être aussi l’occasion de réfléchir à l’ensemble de leur vie, à leurs réussites, triomphes, ratés et regrets, ainsi qu’aux leçons apprises. Ce peut être aussi un moyen de léguer quelques sages paroles qui, dans leur esprit du moins, valent d’être préservées. Les personnes qui, se sachant proches de la fin, décident d’écrire sans fard y trouvent peut-être un éclairage précieux qui leur permet d’accepter paisiblement l’inévitable.
Une vie sous la lorgnette
Thérapeutes, conseillers et coachs en écriture constatent l’effet bénéfique qu’a sur leur clientèle la rédaction de leur propre avis de décès, peu importe leur âge ou le nombre d’années censé leur rester.
L’idée peut sembler morbide, mais elle gagne en popularité comme autoexamen thérapeutique et comme moyen de clarifier certains éléments importants de la vie.
Il n’est pas forcément facile d’envisager sa propre mortalité mais, disent les spécialistes, une réflexion sur ce qu’on aimerait voir dans sa notice nécrologique peut déboucher sur une vie meilleure : plus heureuse, plus sensée et plus productive. Notons d’ailleurs que le verbe obire, racine latine du mot anglais obituary, signifie « aller vers », « se présenter devant ».
« L’exercice amène certaines personnes à jeter un regard critique sur leur vie et à se dire : “Ma vie est tout à fait contraire à ce que je voudrais qu’on retienne de moi” », dit Talia Akerman, conseillère en santé mentale autorisée chez Humantold, à New York. Sa clientèle est composée en majorité de gens dans la jeune vingtaine qui souffrent de dépression, d’anxiété ou d’un traumatisme et qui cherchent une réponse aux grandes questions de la vie tout en tentant de se remettre d’expériences pénibles et de construire leur vie d’adulte.
La thérapie existentielle, démarche largement fondée sur les idées élaborées par Viktor Frankl, psychiatre réputé du début du 20e siècle, invite à rédiger son propre avis de décès comme moyen de trouver un sens et un but authentiques à sa vie. Selon Akerman, « l’exercice vous force à placer un miroir devant votre vie, vos gestes, vos valeurs et les gens qui vous entourent. Il provoque un moment très intense qui vous amènera peut-être à constater que ce reflet ne correspond pas à ce que vous voulez et à apporter des changements. Je demande alors aux gens de repérer des thèmes dans leur notice. “Si vous devez changer quelque chose, comment vous y prendrez-vous?” » Dans d’autres cas, les gens sont surpris que l’image ressemble davantage au portrait espéré qu’ils ne l’attendaient.
Pour une personne qui souffre de dépression, cette rédaction est l’occasion de travailler avec son thérapeute à stimuler son estime de soi, à se reconnecter avec ce qui va bien et à retrouver l’espoir. « Cela leur rappelle leurs forces, ce qui est particulièrement bénéfique, souligne Akerman. Pour certaines personnes vivant avec une maladie mentale, l’exercice est toutefois un peu plus difficile. Tout le monde n’est pas prêt à faire ce bilan. C’est alors qu’un bon thérapeute a un rôle à jouer. Vous devez instiller un espoir dans la personne, l’accompagner le temps qu’elle arrive à s’approprier cet espoir. »
Il peut être utile de relire sa notice nécrologique au bout de quelques mois ou de quelques années pour voir en quoi la vie a changé, pour le meilleur ou pour le pire, et réfléchir de nouveau à la voie à suivre. « J’incite les gens à conserver leur notice, mais si l’idée les bouleverse trop, je propose de la conserver pour eux seuls, dans un endroit sûr, et d’y revenir avec eux, explique Akerman. Ils pourront vérifier s’ils ont apporté les corrections qu’ils souhaitaient ou, dans le cas contraire, pourquoi rien n’a changé. »
Changements de direction
Akerman rappelle que la pandémie en a forcé beaucoup à transformer leur vie professionnelle ou à composer avec des pertes de tous types qui ont parfois mené à une crise de santé mentale, ce qui a rendu la rédaction de la notice nécrologique encore plus pertinente.
« Je pense que cet outil a été vraiment utile pendant la COVID, mentionne-t-elle. Pour plusieurs, à défaut de pouvoir maîtriser quoi que ce soit sur le plan social, il restait possible de déterminer que faire de sa vie, de revenir sur ses valeurs, sur ce qui compte vraiment et sur ce qu’il y avait lieu de changer, sur le plan professionnel ou relationnel. »
Peu importe notre âge et peu importe que la mort soit lointaine ou proche, réfléchir à notre vie passée, présente ou à venir a d’évidents avantages : on y trouve la quiétude nécessaire pour se réorienter et apprécier tout simplement qui on est, où on en est, ce qu’on a accompli et ce qu’on aimerait bien faire avant de disparaître.
Ressource : Partagez votre récit de façon sécuritaire
Lectures complémentaires :

Moira Farr
Journaliste, auteure et professeure primée, est diplômée de l’Université Ryerson et de l’Université de Toronto. Ses écrits ont été publiés notamment dans The Walrus, Canadian Geographic, Châtelaine et The Globe and Mail, et abordent des thèmes comme l’environnement, la santé mentale et les enjeux de genre. Outre l’enseignement et l’édition, elle travaille à son compte en tant qu’auteure, et a également été rédactrice universitaire dans le cadre du programme de journalisme littéraire du Banff Centre for Arts and Creativity.
Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Share This Catalyst
Related Articles
Explorer l’incidence, les ressources et les stratégies de prévention du suicide
Septembre est le Mois de la sensibilisation au suicide. Il s’agit d’un rappel poignant de l’importance de la santé mentale et c’est l’occasion d’informer le public, de comprendre et de défendre les personnes touchées par le suicide.
L’ampleur du problème
Au Canada, le suicide reste un problème de santé publique important, qui touche aussi bien les personnes de tous âges, de tous genres et de tous milieux. Selon Statistique Canada, environ 4 500 personnes meurent par suicide chaque année au pays, soit environ 12 personnes par jour. Pour chaque personne qui décède par suicide, de nombreuses autres sont en proie à des pensées suicidaires ou font des tentatives de suicide. La COVID-19 a également eu des effets négatifs sur la santé mentale, notamment une hausse significative des cas d’idées suicidaires. Chez les jeunes gens (de 15 à 24 ans), le suicide est souvent considéré comme l’une des trois principales causes de décès, et son taux d’incidence est amplifié par ses effets sur les familles, les personnes et les communautés aux quatre coins du pays (et dans le monde entier).
Les raisons du suicide sont complexes : elles sont d’ordre biologique, psychologique, social, culturel, spirituel, économique et autres. Selon un éminent chercheur dans le domaine, les personnes qui songent au suicide et qui font une tentative de suicide désirent mettre fin à une douleur psychologique profonde et intense. Pourtant, malgré la complexité de la question, il y a lieu d’être optimiste.
Il est possible de réduire le taux de suicide et son incidence au Canada au moyen d’interventions empruntées aux domaines de la santé mentale et de la santé publique. Dans ce contexte, le Mois de la sensibilisation au suicide joue un rôle essentiel en sensibilisant le public à cette question et en favorisant le dialogue.
Comment parler du suicide
Plusieurs ressources que la CSMC soutient ou qu’elle a contribué à créer insistent sur l’importance d’une communication ouverte et sans jugement. Il peut être difficile d’entamer une conversation sur le suicide, mais il s’agit d’une étape nécessaire pour aider les personnes qui ont besoin de soutien à aller en chercher.
Parler d’un suicide à des enfants est un outil de conversation destiné à aider les soignants, les parents et les tuteurs à comprendre comment parler aux enfants lorsqu’un suicide se produit dans la communauté ou si une personne qu’ils connaissent est décédée par suicide. La recherche a montré que le fait de parler du suicide n’augmente pas le risque de suicide chez l’enfant. En fait, cela peut être une expérience utile.
Le suicide : Confronter ensemble ce sujet sensible est un module en ligne conçu pour aider les professionnels de la santé à se préparer à de telles conversations. Les fournisseurs de soins de santé jouent un rôle essentiel en matière de prévention du suicide au Canada. Ils sont souvent les mieux placés pour identifier les personnes qui risquent de se suicider et pour leur fournir les soins dont elles ont besoin ou les aiguiller vers ces soins.
À l’heure actuelle, une grande partie de nos interactions se font en ligne. Pour composer avec cette réalité, l’organisme australien, Orygen, a élaboré des lignes directrices pour que les jeunes puissent clavarder en toute sécurité (#ChatSafe), mais cet outil peut servir à tout le monde, peu importe l’âge.
Le guide des médias, En-tête : Reportage et santé mentale s’adresse aux journalistes, mais il est utile à toute personne qui écrit sur le suicide ou sur d’autres sujets sensibles. Les recommandations suivantes sont essentielles pour favoriser la rédaction de reportages sûrs et responsables :
- respecter la vie privée et le deuil des proches;
- inclure les numéros de lignes d’écoute locales vers lesquelles les lecteurs peuvent se tourner pour obtenir du soutien;
- présenter le suicide comme quelque chose qui est évitable.
En outre, les journalistes sont invités à ne pas donner une vision romantique du suicide et à ne pas le présenter comme une solution à des problèmes de la personne, de ne pas détailler la méthode utilisée et de ne pas publier de notes de suicide.
Depuis longtemps, les stratégies nationales de prévention du suicide insistent sur le fait que la couverture médiatique doit être sûre et responsable. Cette recommandation figure en bonne place dans les lignes directrices sur la prévention du suicide des Nations Unies; dans le plan directeur de l’Association canadienne pour la prévention du suicide et dans le rapport sur la prévention du suicide de l’OMS. Pourtant, les films et les émissions de télévision présentent souvent le suicide sous un angle problématique. On peut saisir ces occasions pour engager la conversation et recadrer la question.
Lutter contre la stigmatisation et les idées fausses
L’un des principaux aspects du Mois de la sensibilisation au suicide consiste à lutter contre la stigmatisation et les idées fausses qui entourent la santé mentale et le suicide. Depuis de nombreuses années, la CSMC insiste sur le fait que la stigmatisation nuit aux personnes éprouvant des difficultés sur le plan de la santé mentale. La stigmatisation peut les dissuader de chercher de l’aide, ce qui peut exacerber leurs difficultés et potentiellement avoir des issues tragiques.
En encourageant la compréhension et l’empathie, nous pouvons créer un environnement dans lequel les personnes se sentent en sécurité et à l’aise de parler de leurs problèmes de santé mentale. Dans cet esprit, il faut reconnaître que le fait de demander de l’aide est un signe de force – et non de faiblesse – et que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique.
Moira Farr a écrit After Daniel : A Suicide Survivor’s Tale (Le récit d’une survivante du suicide), qui traite du décès de son partenaire. Journaliste et formatrice, elle effectue des recherches et écrit sur divers sujets pour des publications nationales et internationales, dont Le Vecteur. Elle a remarqué un changement de discours depuis la publication de son livre, en 1999.
« Je dirais que depuis 20 ans, les gens parlent plus ouvertement des problèmes de santé mentale, y compris du suicide, explique-t-elle. Les campagnes de sensibilisation sur les moyens et les endroits où obtenir de l’aide et à amener les gens à parler plus honnêtement de leurs propres problèmes de santé mentale me semblent avoir été une force positive », ajoute-t-elle.
« J’imagine qu’il est difficile de déterminer si cela a permis de réduire le taux global de suicide au Canada. Il peut encore être difficile de trouver les ressources en santé mentale dont on a besoin. Étant donné une plus grande prise de conscience à cet égard, la demande de soins de santé mentale a augmenté, et il n’y en a pas nécessairement assez pour tout le monde. »
Temps d’attente
Il est important de disposer de soutiens en santé mentale pour intervenir en cas de suicide. Cependant, selon l’Institut canadien d’information sur la santé, il faut compter en moyenne 22 jours à l’échelle nationale avant de pouvoir pour obtenir des services de psychothérapie au sein de la communauté.
Pourtant, les stratégies provinciales visant à réduire les temps d’attente sont prometteuses. L’Île-du-Prince-Édouard insiste sur la nécessité d’augmenter les points d’accès aux soins, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des hôpitaux. Face aux longs délais d’attente pour se prévaloir de services de santé mentale dans la province, l’Île-du-Prince-Édouard a commencé à s’inspirer de sa voisine, Terre-Neuve-et-Labrador, qui a récemment réduit de 67 % les délais d’attente dans ce domaine. L’Île-du-Prince-Édouard suit maintenant le mouvement en mettant également en œuvre le modèle de soins par paliers 2.0, qui permet de fournir des services plus rapides et plus holistiques grâce à une série de méthodes comme la télésanté, les services en ligne et les cliniques sans rendez-vous.
Le modèle de soins par paliers 2.0 s’articule autour de neuf étapes, dont le soutien informationnel, les soins autogérés, les soins actifs, la navigation dans les systèmes, la gestion de cas et la défense des droits. Pour mettre en œuvre le modèle, les organismes de services choisissent des stratégies en fonction des besoins et des préférences de chaque client (p. ex., les interventions de cybersanté mentale, l’autoassistance, le soutien par les pairs, la thérapie en personne) qui s’harmonisent avec cette structure et le nombre d’étapes qui convient pour chaque collectivité.
Ligne d’écoute à trois chiffres
Un autre soutien important — le numéro d’appel d’urgence 988 pour la prévention du suicide et la résolution de crises en santé mentale — sera mis en place en novembre. Les personnes ayant besoin d’un soutien psychologique immédiat pourront composer le 988 ou envoyer un texto à ce numéro pour être dirigées vers un service d’aide gratuit de prévention du suicide ou de crise en santé mentale.
Cette idée fait l’objet d’une étude sérieuse depuis plusieurs années au Canada, et reçoit un soutien enthousiaste d’experts en prévention du suicide, de professionnels de la santé mentale et des représentants politiques de tous les ordres de gouvernement. Au cours des dernières années, d’autres pays comme les Pays-Bas et les États-Unis ont également mis en place un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide.
Les voies vers l’avenir
Par ailleurs, en juin, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a publié un rapport intitulé Se laisser guider par les résultats : repenser le Cadre fédéral de prévention du suicide, dans lequel il formule une série de recommandations, dont les suivantes :
- reconnaître l’impact de la consommation de substances sur la prévention du suicide au Canada et financer la recherche sur les interventions;
- créer une base de données nationale permettant de mieux recueillir les données nationales sur le suicide, les tentatives de suicide et les mesures de prévention efficaces;
- remplacer les axes d’« espoir » et de « résilience » mentionnés dans le Cadre fédéral de prévention du suicide par ceux de « sens » et de « connectivité ».
Ce changement de termes fait écho à d’autres perspectives. Par exemple, dans de nombreuses communautés autochtones, des termes comme « promotion de la vie » ou « mieux-être » sont souvent utilisés pour aborder le sujet de la prévention du suicide. Le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations — mis au point par la fondation Thunderbird Partnership, avec des partenaires autochtones et non autochtones (y compris Santé Canada) — souligne que l’espoir, le sens, le sentiment d’appartenance et le fait d’avoir un but sont le socle de nombreux modes de connaissance autochtones. Comme l’explique le Cadre, si ces quatre aspects sont en harmonie dans la vie quotidienne d’une personne, elle éprouve un sentiment de plénitude qui la protège et agit comme un amortisseur contre les risques pour la santé mentale et les comportements suicidaires potentiels.
L’importance de la communauté et du soutien
Pendant le Mois de la sensibilisation au suicide, les communautés de tout le Canada se rassemblent pour offrir un soutien et des ressources aux personnes touchées par le suicide. Ces efforts comprennent des campagnes de sensibilisation, des événements éducatifs et des initiatives visant à réduire la stigmatisation et à favoriser les réseaux de soutien en matière de santé mentale.
Les ressources de la CSMC soulignent l’importance de bâtir une communauté forte et solidaire pour contribuer à la prévention du suicide. En travaillant ensemble et en favorisant les liens, nous pouvons créer un environnement dans lequel les personnes en crise se sentent valorisées et comprises. Le Mois de la sensibilisation au suicide au Canada nous rappelle que nous pouvons tous jouer un rôle en matière de prévention du suicide.
Espace Mieux-être Canada – soutien en cas de crise : Si vous vivez de la détresse, à n’importe quel moment, vous pouvez texter MIEUX au 741741. S’il s’agit d’une urgence, composez le 911 ou rendez-vous à votre service des urgences local.
Aide : Les personnes en détresse mentale au Canada peuvent obtenir de l’aide par l’intermédiaire de Parlons Suicide Canada en composant le numéro sans frais 1-833-456-4566.
Cours : Premiers soins en santé mentale porte sur la manière d’aider une personne aux prises avec un problème de santé mentale, qui traverse une crise de santé mentale ou dont l’état de santé mentale s’aggrave.
Ressource : Prévention du suicide (Commission de la santé mentale du Canada).
Lectures suggérées : Un numéro de téléphone à trois chiffres facile que nous mémoriserons toutes et tous bientôt.

Fateema Sayani
Une habituée des organismes à vocation sociale, ainsi que des salles de presse, où elle a passé plus de 20 ans aux commandes de nombreuses activités, de la stratégie à la collecte de fonds. Ses écrits, qui couvrent une foule de sujets allant des politiques à la culture populaire, sont parus dans des publications de premier plan à la grandeur du Canada et lui ont valu des prix pour ses reportages sur la justice sociale. Forte de ses diplômes, de ses certificats et de ses activités bénévoles, elle s’est donné pour mission de changer l’image des communautés sous-représentées. Malgré son horaire chargé, elle trouve encore le temps de se plonger dans la scène musicale canadienne.
Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Share This Catalyst
Related Articles
Dans son nouveau livre, l’autrice Jennifer Mullan jette un regard critique sur les soins de santé.
L’accès aux soins est parsemé de beaucoup trop d’embûches, ce qui donne lieu à « un système de bien-être vétuste, exempt de bien-être. » Ce sont les mots de Jennifer Mullan, psychologue clinique établie au New Jersey et autrice du livre Decolonizing Therapy: Oppression, Historical Trauma, and Politicizing Your Practice, qui paraîtra prochainement.
Selon Mullan, bien des gens se perdent dans un parcours d’obstacles lorsqu’ils cherchent à obtenir des soins, une expérience qui reflète ce qu’elle a baptisé le Complexe industriel de la maladie mentale. En réaction à ce constat, elle s’est jointe à un « mouvement grandissant de praticiens qui désapprennent les méthodes coloniales de la psychologie », cherchant ni plus ni moins à refondre et à restructurer le système.
Les dix chapitres du bouquin regorgent d’observations cinglantes et de réflexions critiques, sous des titres comme « Entre lobotomie et libération », « L’esclavage du diagnostic » et « Travail émotionnel-décolonial ». Tout au long des 400 pages que contient le livre, l’autrice explore un vaste éventail de problèmes plombant le système de santé mentale aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Ces systèmes fonctionnent comme des portes tournantes, en traitant de nombreux clients, sans toutefois ne jamais s’attaquer à la racine de la douleur individuelle. Elle est convaincue que cette défaillance explique en partie les actes de violence qui font rage de plus en plus souvent aux É.-U., comme les fusillades dans les écoles, les taux de dépression en hausse et l’augmentation des problèmes de santé mentale.
Pendant une grande partie de sa carrière, Mullan a travaillé en thérapie avec des enfants et des adultes ayant des antécédents de violence domestique, de mésusage de substances, de maltraitance durant l’enfance, de pauvreté et de problèmes liés à l’identité de genre. Au fil des ans, ces rencontres ont fini par miner son optimisme et alimenter sa frustration.
Taire le passé
Si Mullan décortique plusieurs facteurs faisant obstacle à des traitements efficaces, elle réserve toutefois ses critiques les plus acerbes au défaut du système de reconnaître les traumatismes intergénérationnels, qui sont – elle est en convaincue – la cause profonde de bien des problèmes de santé mentale.
C’est pourquoi elle présente son livre comme « un APPEL à l’ACTION lancé aux professionnels de la santé mentale, aidants et travailleurs du bien-être. Si nous souhaitons “traiter”, guérir et informer une personne, un groupe, une organisation, demande-t-elle, n’est-il pas essentiel de tenir compte également de l’historique, du vécu et des traumatismes culturels? »
Le traumatisme intergénérationnel n’est pas un concept nouveau. Il a gagné en crédibilité lorsque des chercheurs se sont intéressés aux effets de l’Holocauste perpétré en Allemagne nazie. Aujourd’hui, un corpus croissant de recherches canadiennes fait le rapprochement entre ces traumatismes et les abus subis dans les pensionnats autochtones. Une vidéo de Historica Canada décrit les expériences vécues en ces termes : « Pour bien des [survivants des pensionnats], les traumatismes psychologiques, physiques et sexuels vécus ne se sont pas estompés. Les enfants et les petits-enfants des survivants ont reçu ces blessures en héritage. Elles ont persisté, se sont manifestées sous forme de dépression, d’anxiété, de violence familiale, de pensées suicidaires et de la consommation de substances. » Une étude de l’Office for Institutional Equity de l’Université Duke illustre comment les traumatismes peuvent traverser les générations : « Il peut être très difficile pour un parent ou un grand-parent qui n’a jamais vraiment fouillé ses propres traumatismes ou guéri de ceux-ci d’offrir du soutien émotionnel à un membre de sa famille qui vit ses propres traumatismes. »
Jennifer Mullan explore ces thèmes en profondeur dans Decolonizing Therapy, où elle revient sur l’esclavage, les camps d’internement, les dictatures et les pensionnats, tout en soutenant que le défaut de se pencher sur ces pans de l’histoire condamne les générations futures à un cycle de souffrance perpétuel. La thérapie qu’elle prescrit ne se limite donc pas à l’étude de l’historique familial de la personne, mais englobe sa culture, ses traditions, ses rituels, ses croyances et ses pratiques religieuses. Lorsque ses traumatismes enfouis sont mis au jour, le patient est en mesure de recevoir des traitements plus ciblés.
Malheureusement, bien des thérapeutes n’ont appris aucune notion sur les traumatismes intergénérationnels et sont même mis en garde contre toute évocation du passé.
« Dans leur formation, déplore-t-elle, bien des thérapeutes et travailleurs sociaux ont appris à toujours rester neutres, à n’exprimer aucune opinion et à ne rien montrer dans leur bureau qui soit politique ou provocant. On ne parle pas de l’histoire des Noirs. On ne parle pas d’esclavage. On ne parle pas de racisme. »
Attendre et vouloir
Les séances de counseling se résument habituellement à de brèves conversations laissant peu de temps pour approfondir les sujets. Pour insister sur ce point, Mullan cite en exemple un collègue œuvrant dans une clinique communautaire où il reçoit plus de 90 clients par deux semaines. Et dans son ancien poste de psychologue à l’emploi d’une université, la liste d’attente pour le counseling s’est maintenue à près de 100 étudiants pendant six mois sans interruption. « Les ressources ont été distribuées de façon inadéquate, voire criminelle », soutient-elle. Cela fait en sorte que dans bien des établissements, « les fonds doivent être réorientés ».
La question de l’écrasante charge de travail s’ajoute à ces difficultés en causant des problèmes de santé mentale et physique aux thérapeutes eux-mêmes. Le livre décrit en détail les conditions abominables que vivent certains thérapeutes, qui doivent occuper un deuxième emploi pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, rembourser leur prêt étudiant, composer avec d’intenses traumatismes indirects en raison des charges qu’ils aident leurs clients à porter, se surcharger en gérant jusqu’à 80 cas par mois, passer d’un emploi à l’autre, vivre de l’épuisement professionnel, faire constamment l’objet de microagressions, de préjugés, de discrimination.
Un thérapeute cité dans le livre décrit les suites de la crise cardiaque qu’il a vécue dans son bureau. « Ce n’était pas de la faute du client. Je considérais que c’était de ma faute. J’ai alors changé mon alimentation et commencé à faire plus d’exercice. Je suis retourné au travail, mais j’avais des crises de panique entre mes clients. Mon supérieur m’a dit : “Tu dois te reposer davantage. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu consultes toi aussi un thérapeute?” Les autosoins ne vont pas guérir mon cœur, mon anxiété et mon système nerveux. »
Changer de vitesse
Il y a quelques années, Mullan a décidé d’arrêter d’accepter des patients pour plutôt se concentrer à réformer le système au moyen de conférences et de son livre, qui propose aussi des idées pour une réforme plus profonde.
Bien que ses opinions tirent leur origine des États-Unis, ses appels à l’action pourraient résonner dans de nombreux pays. Ici au Canada, des initiatives comme le Modèle de soins par paliers 2.0, qui sont déjà en place à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse et ailleurs, ont radicalement réduit les temps d’attente pour des services de santé mentale. De plus, davantage d’organisations reconnaissent aujourd’hui les moyens de guérison autochtones comme des formes de thérapie éclairées et culturellement pertinentes. Aussi, un récent programme de la Commission de la santé mentale du Canada et du Centre de toxicomanie et de santé mentale propose une thérapie cognitivo-comportementale adaptée à la culture des communautés sud-asiatiques.
Comme de nombreuses publications traitant de santé mentale, Decolonizing Therapy contient des exercices, des questions de révision et des références détaillées. Ce qui fait sortir l’ouvrage du lot est son ton fougueux, passionné et provocateur, conjugué à la personnalité de Mullan, toujours en filigrane. « Je tiens le Complexe industriel de la maladie mentale pour responsable et, de concert avec vous cher lecteur, je réclame du changement », écrit-elle.
Ses opinions sont vues comme controversées dans certains cercles, et certains de ses collègues n’appuient pas son activisme. Un ancien professeur pour lequel elle a beaucoup de respect lui a déjà déconseillé de mêler la politique à la psychologie. Mais Mullan voit les choses autrement. En fait, en braquant les projecteurs sur des sujets difficiles, son livre est spécialement conçu pour changer ce discours.
Ressource : Fiche d’information :Idées reçues et mythes courants sur la santé mentale
Autres lectures : La TCC pour vous et moi : Une série d’outils de thérapie cognitivo-comportementale culturellement adaptée, conçue pour faire tomber les barrières.
Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Share This Catalyst
Related Articles
Quand une taille unique ne convient pas à tous. Un regard sur l’approche de Waypoint en matière de psychothérapie structurée.
Sur les rives de la baie Georgienne, à Penetanguishene, un hôpital spécialisé dans les soins de santé mentale mène actuellement un travail particulièrement innovant. Outre ses 301 lits, le Centre de soins de santé mentale Waypoint abrite le seul programme de santé mentale médico-légale hautement sécurisé de l’Ontario pour les patients pris en charge par les systèmes de santé mentale et de justice. La gamme de services couvre les services de soins aigus de psychiatrie ainsi que ceux à plus long terme pour les patients hospitalisés et les patients en consultation externe de la région. Dernièrement, la prestation du programme de psychothérapie structurée de l’Ontario (PSO) a été reconnue pour son incidence majeure.
En juin, j’ai eu l’honneur de remettre à ce groupe, composé de Jessica Ariss, responsable du programme Waypoint, et de Jeannie Borg, directrice de l’innovation des systèmes au Centre Waypoint, le prix d’excellence 2023 pour l’amélioration de la qualité dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie, décerné par le Collège canadien des leaders en santé (CCLS). J’ai interrogé l’équipe sur son approche de l’amélioration des résultats en matière de santé mentale.
Des soins transformateurs
La PSO offre un traitement financé par l’État aux personnes souffrant de dépression, d’anxiété et de troubles liés à l’anxiété en leur donnant accès à une thérapie cognitivo-comportementale (ou TCC) à court terme et fondée sur des données probantes, une forme de soins qui aide les personnes à examiner comment elles donnent un sens à ce qui se passe autour d’elles et comment ces perceptions influencent la façon dont elles se sentent.
Waypoint propose la TCC dans le cadre de partenariats établis avec plus de 20 organisations. Cela signifie que les personnes peuvent accéder aux soins dans leur communauté plutôt que de devoir se rendre dans un point central. Grâce à ce modèle, la thérapie est proposée gratuitement aux clients. Bien qu’il s’agisse d’un traitement très efficace qui améliore les symptômes et réduit la probabilité que les problèmes de santé mentale deviennent pressants, Waypoint est loin d’être le seul organisme à proposer la TCC.
Qu’est-ce qui rend son programme différent et digne d’obtenir un prix?
Une attention aux lacunes
Waypoint a remporté le prix en raison de sa ténacité à combler les lacunes en matière de soins. L’organisme s’est efforcé d’améliorer l’accès à la TCC pour les populations prioritaires, notamment les Autochtones, les francophones et les personnes 2SLGBTQI+, ce qui a permis d’augmenter le nombre d’aiguillages vers les programmes de l’organisme. Dans un cas, Waypoint a utilisé ses canaux de communication pour promouvoir en ligne les services destinés aux communautés prioritaires et suivre le processus des clics jusqu’aux aiguillages. Cette partie du projet a adopté une approche globale couvrant la formation, les stratégies de communication et la modification des services. Ces modifications ont été décidées par des cercles consultatifs composés de patients et d’autres personnes ayant un savoir expérientiel passé et présent au sein de diverses communautés.

Les membres du programme PSO et du Cercle de santé autochtone, qui ont travaillé ensemble à l’adaptation et à l’amélioration des services pour les clients autochtones : (de gauche à droite) Charity Fleming, David Thériault, Jessica Ariss, Germaine Elliott, Leah Lalonde, Melissa Petlichkov et Melissa Moreau.
Pour les populations autochtones, l’équipe de Waypoint a travaillé avec le Indigenous Health Circle B’Saanibamaadsiwin et le Barrie Area Native Advisory Circle pour développer des protocoles cliniques et à des plans de soins intégrés pour les services de TCC. Ces protocoles s’appuient sur les commentaires des clients, les résultats de la recherche et un cours de formation (offert par l’Université Wilfrid Laurier) intitulé Sacred Circle CBT – Mikwendaagwad, un mot Anishinaabemowin/ojibwé signifiant « On s’en souvient, on y pense ». Les voies de services aux Autochtones – appelées Minookmii ou « pistes sacrées sur la terre » – utilisent un processus adapté d’évaluation des admissions mené par un clinicien autochtone et des services qui incluent des guérisseurs spirituels. Ces pratiques autochtones de promotion de la santé garantissent que les perspectives et les besoins des populations prioritaires sont au cœur des processus de développement et d’évaluation des services de Waypoint.
Données et attitude
L’organisme suit ces processus à l’aide d’un système de tableau de bord qui prend en compte des mesures quantitatives et qualitatives. La rétroaction qualitative est intégrée aux examens cliniques dans le cadre d’une boucle d’amélioration continue. Mais Waypoint ne laisse jamais son engagement envers les tableaux de bord et les données entraver la touche personnelle. Le centre a su trouver l’équilibre entre l’analyse et l’empathie, en veillant à ce que les éléments humains et les modèles se complètent pour donner des soins significatifs.
Par exemple, un clinicien rencontrera un client pour déterminer le service qui répond le mieux à ses besoins. Qu’il s’agisse d’une suerie, d’une purification, d’un contact avec un aîné ou d’une autre approche autochtone des soins – ou d’autre chose comme la bibliothérapie assistée par un clinicien – c’est une prise en charge significative, participative et engagée. Comme l’a dit un participant : « Dès les premières minutes de notre rencontre, la thérapeute avec laquelle j’ai été jumelé a créé un espace où l’on se sentait en sécurité pour partager. Sa gentillesse, ses connaissances et son attitude chaleureuse m’ont encouragé à parler plus honnêtement et plus ouvertement de mon anxiété que je ne l’avais jamais fait auparavant. Elle a transmis des renseignements, des statistiques, des études, des données non scientifiques et des exemples qui m’ont aidé à voir mon anxiété liée à la santé sous un angle différent – et aussi à me sentir moins seul dans mes luttes ».
Ce sont ces différences qui distinguent le programme, ce que Heather Bullock, vice-présidente des partenariats et responsable de la stratégie de Waypoint, considère comme remarquable.
« Le programme est fidèle à sa vision », souligne-t-elle. En d’autres termes, ce ne sont pas que des éléments qu’il est bon d’avoir, mais plutôt des processus intégrés. « Il n’y a pas d’écart entre la vision et la réalité », dit-elle en mentionnant leur travail avec les collèges, les cliniques et les différents environnements culturels. « Nous avons réussi à rassembler les communautés et les différents types de fournisseurs autour d’un objectif commun. Nous construisons quelque chose de la manière dont nous voulons qu’il soit construit; c’est quelque chose qui s’harmonise non pas avec ce dont nous aurons besoin dans le futur, mais avec ce dont nous avons besoin aujourd’hui ».
Ressource : Webinaire sur la cybersanté mentale et les partenariats autochtones dans la prévention du suicide. Comment Jeunesse, J’écoute se sert des services de cybersanté mentale pour éliminer les obstacles à l’accès et fait usage des données pour étayer ses efforts de prévention du suicide.
Pour en savoir plus : Le Vecteur : Conversations sur la santé mentale. La TCC pour vous et pour moi.
Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Share This Catalyst
Related Articles
Un nouveau plan pour des changements véritables
« J’ai longtemps cru que j’étais une mauvaise personne qui essayait d’être bonne, raconte Steven Deveau, directeur général de 7th Step Society of Nova Scotia, un organisme géré par des pairs qui offre du soutien aux personnes qui ont été incarcérées. Ma vision a changé lorsque j’ai compris que j’étais plutôt une personne malade qui tentait d’aller mieux. »
Bon nombre des personnes ayant eu des démêlés avec la justice partagent sans doute cette perception de Steven Deveau, qui a lui-même vécu des choses similaires. Dans l’ensemble, 73 % des hommes et 79 % des femmes qui ont été incarcérés dans une prison fédérale présentent des symptômes d’un ou de plusieurs problèmes de santé mentale. Ces chiffres montrent la nécessité d’accroître l’accès à des services de santé mentale de qualité, tant au sein des établissements correctionnels que dans la communauté, ainsi qu’à d’autres services de prévention et d’intervention précoce, notamment en matière de logement et d’éducation. Comme pour tous les problèmes de santé mentale, il est essentiel que les gens reçoivent de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. Pourtant, il y a jusqu’à présent bien peu de progrès tangible en la matière.
Pas qu’un énième rapport
« Des gens sollicitent mon avis et me demandent ce qu’ils peuvent faire pour améliorer la situation, dit Mo Korchinski, directrice générale de l’organisme Unlocking the Gates Services Society. Puis, la question demeure lettre morte, dans un énième rapport oublié sur le coin d’un bureau. Je veux que les choses changent. »
Inspirée notamment par cet appel au changement, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) s’emploie à élaborer un plan d’action pour le Canada afin de favoriser la santé mentale et le bien-être des personnes qui ont des démêlés avec la justice. Le plan d’action s’appuie sur l’expertise des personnes qui ont vécu et qui vivent la maladie mentale, ainsi que d’autres experts qui mettent en lumière ces questions depuis des années. Le plan d’action s’appuie aussi sur les travaux pertinents des deux dernières décennies, dont la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada qu’a publiée la CSMC en 2012 et qui fait de la justice pénale une priorité, ainsi que sur les travaux en cours qui ciblent les actions susceptibles d’être mises en œuvre. Ce projet pancanadien sera vaste et exhaustif. Il mettra l’accent sur la prévention en amont et l’intervention précoce, la structure, la réforme législative, la transformation du système, et l’évaluation des mesures de soutien en matière de santé mentale pour tous les types d’interactions avec la justice, du premier contact avec la police à la réinsertion dans la communauté.

A.J. Grant-Nicholson
Vue de l’intérieur
« J’ai fait mon stage dans un bureau d’avocats de service d’un tribunal pénal et j’ai vite constaté l’intersectionnalité de la santé mentale et du système judiciaire », révèle A.J. Grant-Nicholson, avocat principal du cabinet Grant-Nicholson Law et conseiller dans le cadre du projet de plan d’action.
« Trop souvent, j’ai vu des accusés souffrant de problèmes cognitifs, de traumatismes, de maladies psychiatriques ou encore de problèmes de consommation de substances et de santé mentale qui ont un lien direct avec les accusations portées contre eux, explique-t-il. J’ai vite compris que le système judiciaire est un dernier recours, et parfois une voie inévitable pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. »
Il en a fait le fondement de sa carrière. Après son stage, il a travaillé comme avocat spécialisé en santé mentale pour l’organisme Aide juridique Ontario, premier poste du genre dans la province, un rôle au sein duquel il représentait des clients devant la Commission du consentement et de la capacité. Il a aussi été avocat de service dans un hôpital spécialisé en psychiatrie médicolégale, ainsi que pour un tribunal en santé mentale.
« J’ai constaté que le système judiciaire n’était pas l’endroit idéal pour remédier aux problèmes de santé mentale, précise-t-il. Les avocats de la défense, les procureurs, les juges de paix et les juges ne sont pas des cliniciens. Le droit pénal est un instrument sans nuances dont la capacité de fournir un soutien thérapeutique aux accusés ayant des problèmes de santé mentale est limitée. »
Il admet qu’il y a « de plus en plus de services de soutien en santé mentale dans les cours pénales, notamment un tribunal en santé mentale désigné où les accusés peuvent être mis en contact avec des travailleurs en santé mentale et des programmes de soins de santé mentale ». Toutefois, la disponibilité et la portée de ce soutien varient d’une région à l’autre. Les accusés ne connaissent souvent pas les services de soutien en santé mentale qui sont offerts.
Une part importante des personnes incarcérées que représente cet avocat ont des problèmes graves de santé mentale, parfois accompagnés de problèmes de dépendance. Le croisement entre les problèmes de santé mentale et le système judiciaire est manifeste dans les centres de détention.
« À l’évidence, ces établissements sont loin d’être propices à la guérison, dit-il. L’incarcération exacerbe même les problèmes de santé mentale. J’ai également vu bon nombre de clients dont les problèmes de santé mentale se détériorent une fois remis en liberté et qui, inévitablement, se retrouvent encore une fois devant la justice, souvent en raison des obstacles qui les empêchent de se prévaloir de services sociaux et de soins de santé dans la communauté ou encore de trouver un logement convenable. »
Constatant ces lacunes, il cherche donc à apporter des changements véritables. « J’espère que le plan d’action fournira aux parties prenantes les informations nécessaires qui permettront de mieux outiller le système judiciaire pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et qu’au fil du temps, ces personnes seront moins nombreuses à prendre le chemin de la prison et que le taux de récidive diminuera chez cette population. »
C’est pourquoi le Canada doit absolument se doter de ce plan d’action en matière de santé mentale et de justice pénale, dit l’avocat. Steven Deveau voit aussi de l’espoir dans le projet et le comité responsable. Il est convaincu que le projet peut réellement changer des vies et des communautés.
« J’aime à dire que si je me suis réveillé ce matin sobre et libre de ma prison physique et mentale, alors c’est un bon jour. Même les petites choses peuvent être des plus motivantes. »
Apprenez-en davantage sur le plan d’action et la façon dont vous pouvez contribuer à son succès.
Ressource : Santé mentale et justice pénale : Quel est l’enjeu?
Lectures suggérées : « Un nom et un visage ». Une cinéaste raconte à quel point il est facile pour une personne atteinte d’une maladie mentale de se retrouver à la rue ou face à la justice pénale.
Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Share This Catalyst
Related Articles
Il est temps de recadrer la masculinité – une étape à la fois
Beyoncé et Kendrick chantaient les problèmes de l’Amérique tandis que notre camion roulait vers notre lieu de randonnée. Mon mari tenait le volant, avec sa jovialité habituelle. Il parlait de l’influence des mouvements historiques sur la musique. Il était 6 h 30. Mon mari est abominablement matinal et nous étions en route pour une randonnée de huit kilomètres, le long de l’escarpement de la Gatineau, au Québec.
Notre fils – qui n’est ni matinal ni particulièrement épris de randonnée – s’occupait de la musique sur la banquette arrière. Il était juste là pour gagner un pari.
De mon côté, malgré mon humeur plus taciturne, j’étais heureuse de partir en excursion. Mais je me méfiais de la dynamique qui était en train de s’installer entre le père et le fils. Les hommes peuvent être bizarres et compétitifs, même lorsqu’ils essaient d’être détendus.
Macho, Macho Man
Les comportements machistes ont commencé dans le stationnement, lorsque mon fils est sorti du camion avec un chandail et une tasse de café à la main.
Mon mari a dit : « Laisse ton chandail et ton café ici », ce qui a incité mon fils à prendre un air rebelle et à saisir sa tasse de café et son pull avec détermination.
Avant que la dispute la plus stupide du monde n’éclate à propos d’un tricot et d’une tasse de voyage, j’ai lancé à mon mari : « Tu ne les porteras pas, alors laisse tomber. » Et à l’intention de mon fils, j’ai ajouté : « Il va faire chaud et il y aura des insectes – es-tu sûr de vouloir apporter tout ça? »
Pour éviter l’inévitable joute entre deux mâles alpha, je me suis immédiatement placée en tête de la file. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que les hommes sont bizarres. Pourquoi est-il si important d’être le premier? Ce n’est pas une course. Aucun prix ne nous attend. Les normes sociétales ne rendent pas service aux hommes lorsqu’elles les incitent à se montrer dominants.
Mon fils ne sait absolument pas quelle direction nous devons suivre, et pourtant il est prêt à marcher en tête. Mon mari, qui m’encourage régulièrement à prendre les devants lorsque nous sommes tous les deux, veut soudain donner le rythme. Pas étonnant que la santé mentale des hommes soit dans un tel état, me dis-je en observant cette scène… Comment aller demander de l’aide quand on est convaincu d’avoir toutes les réponses?
Oui, je sais, on ne peut pas mettre tous les hommes dans le même sac. Mais les statistiques en disent long et on ne peut les ignorer.
Au Canada, 12 personnes se suicident chaque jour – Statistique Canada en dénombre jusqu’à 4 500 par an – et le taux de suicide des hommes est trois fois plus élevé que celui des femmes.
Selon les études de la Commission de la santé mentale du Canada, par rapport aux hommes de la population générale, les hommes autochtones présentent des taux plus élevés de comportement suicidaire – ce qui englobe les idées suicidaires, les tentatives de suicide et les décès par suicide. Les tentatives de suicide sont dix fois plus nombreuses chez les jeunes hommes inuits que chez les jeunes hommes non autochtones et, par rapport aux hommes hétérosexuels, les hommes appartenant à une minorité sexuelle (tels que ceux qui s’identifient comme gais, bisexuels ou queers) sont jusqu’à six fois plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires.
Un homme, ça ne pleure pas
Mon mari est brillant à bien des égards, y compris pour ce qui est de taire les choses importantes qui lui arrivent. Mais je commence à me demander si le stoïcisme dont lui-même et nos amis masculins font preuve n’est pas le symptôme d’une sorte de blocage des émotions, que les hommes apprennent dès l’enfance par la socialisation. Des problèmes de santé? Ils disparaîtront d’eux-mêmes. Des problèmes au travail? Pas grave. Des problèmes familiaux? Oubliez ça.
Si l’on y réfléchit bien, les statistiques ne sont pas surprenantes. Les hommes vivant dans des milieux où ils se sentent obligés de correspondre à certaines normes, comme la force, la solidité et l’autonomie peuvent entretenir des croyances négatives au sujet de la santé mentale. Les hommes qui adhèrent fortement à ces normes pourraient avoir plus de difficulté à reconnaître les signes de la maladie mentale chez eux-mêmes et chez les autres et être moins enclins à recourir à des services de santé mentale.
Il faudrait donc commencer par recadrer la « masculinité » pour que les émotions puissent être reconnues et exprimées et pour inciter les hommes à rechercher de l’aide.
Sur l’île du Cap-Breton, une nouvelle génération d’hommes de la Première Nation Eskasoni apprend cette leçon. GuysWork, un programme de la Nouvelle-Écosse lancé en 2012, offre un espace sûr pour parler des aspects toxiques de la masculinité. Des animateurs masculins discutent de différents sujets avec des groupes d’adolescents, par exemple, des soins de santé, des ressources en santé mentale, de la violence entre partenaires intimes et des clés d’une relation saine. Par ailleurs, le coffret Cards of Masculinity de NextGenMen présente 50 questions audacieuses sur des thèmes comme l’objectification sexuelle et la culture des aventures sexuelles, afin de faciliter des discussions sérieuses sur les croyances et les comportements des garçons.
Ces organismes s’efforcent de changer l’image d’une masculinité périmée – une masculinité qui suscite un sentiment d’isolement chez les hommes et qui les laisse incapables d’exprimer leurs émotions et réticents à demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin.
Ces efforts collectifs contribuent à déstigmatiser la maladie mentale chez les hommes, à accroître la qualité de leurs relations avec les fournisseurs de soins de santé et à ouvrir de nouvelles voies pour créer des relations interpersonnelles plus satisfaisantes.
Les programmes axés sur les activités réalisées côte à côte (p. ex., le camping, le sport, l’art, la mécanique automobile) plutôt que sur une thérapie en face à face axée sur la conversation pourraient aider à alimenter la discussion.
Prochaines étapes
Mais revenons à notre randonnée. Mon mari indique le chemin qu’il préfère, celui qui monte sur une pente rocailleuse. Évidemment, mon fils en préfère un autre, plus difficile. Non, aucun sens caché ici.
Nous l’avons tiré du lit pour faire une randonnée, car nous étions inquiets : il a besoin de s’activer pour se remettre en forme physiquement et mentalement. Alors, mon mari a parié avec lui qu’il ne pourrait pas se lever assez tôt pour nous accompagner.
Mon mari avait l’habitude de courir pour se maintenir en forme, mais il a dû arrêter à cause d’une série de problèmes de santé. J’ai commencé à m’inquiéter pour lui. Je suppose qu’il s’inquiétait aussi. Puis nous avons découvert que, s’il ne pouvait plus courir, il pouvait faire de la randonnée. Alors le monde a changé. Courir dans le quartier, c’était bien, mais faire de la randonnée dans la forêt, c’était transformationnel.
Mieux encore, la randonnée est une activité que mon mari et moi pouvons pratiquer ensemble. Certaines de nos conversations les plus agréables et les plus enrichissantes ont eu lieu sur un sentier. Nous avons parlé de problèmes professionnels tout en admirant des trilles sauvages et résolu des questions profondément personnelles en regardant passer un cerf de Virginie. Parler nous fait du bien et nous pousse à réfléchir davantage.
Deux heures plus tard, alors que le sentier tire à sa fin, mon fils est en tête, chandail autour de la taille et tasse à café encore pleine. Et nous sommes tout sourires.
Ressource : La santé mentale et le suicide chez les hommes au Canada – Faits saillants
Autres lectures : Tisser des liens malgré les difficultés : L’ABC des soins de santé mentale pour les personnes ACN
Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Articles Connexes
Si le courant ne passe pas, ne disparaissez pas subitement. Exprimez-vous.
Dans un célèbre épisode de la série télévisée Curb Your Enthusiasm (Cache ta joie), Larry David, le personnage principal bourru (qui serait une version caricaturale de David lui-même), décide de mettre fin à sa thérapie après avoir vu son psychiatre d’âge mûr à la plage, en string. Lorsqu’il annonce son intention de partir, le psychiatre semble surpris et insiste auprès de Larry pour qu’il lui dise pourquoi c’est terminé. Larry esquive les questions, puis s’en va sans explications.
En fait, les raisons pour mettre fin à une thérapie et la façon de « quitter » son thérapeute sont, pour la plupart des gens, plus compliquées que ce scénario ne le suggère. Dans l’idéal, la décision de passer à autre chose est mutuelle, anticipée et planifiée. Si votre thérapeute vous convient et que vous avez établi une relation de confiance, vous saurez probablement tous les deux quand il sera judicieux vous séparer. Il est également probable que vous puissiez en discuter ouvertement. Vous vous sentez mieux, vous avez travaillé ensemble pour mieux comprendre les difficultés qui vous ont amené à suivre une thérapie, vous avez fait un deuil, travaillé à améliorer ou à abandonner des relations toxiques, commencé à guérir d’un traumatisme, etc. Aujourd’hui, vous sentez tous deux que vous avez les outils et la compréhension nécessaires pour faire face aux situations qui déclenchent de l’anxiété ou d’autres problèmes. Vous avez grandi, votre thérapeute vous a vraiment aidé et, dans le respect et la bonne volonté des deux parties, le moment est venu de vous séparer.
Mais que se passe-t-il si votre thérapeute et vous ne faites pas bon ménage? Il ne semble tout simplement pas vous « comprendre » et il est peu probable que vous vous sentiez mieux de sitôt. Bien que le conseil le plus fréquent soit de « magasiner un thérapeute », en pratique, il peut être difficile de raconter son histoire, avec tous ses détails intimes et douloureux, plusieurs fois à différents inconnus. Ce genre de réticence peut vous inciter à rester fidèle au thérapeute qui vous accompagne, malgré vos réserves.
À ce stade, il est bien trop facile de justifier le fait de rester en terrain connu. Il est possible que vous utilisiez des ressources communautaires ou en milieu de travail, où les services sont plus abordables. Ou peut-être avez-vous du mal à vous affirmer. Peut-être ne voulez-vous pas dire quelque chose qui pourrait blesser votre thérapeute ou l’amener à vous juger. Bien que chacune de ces raisons puisse être valable, si vous continuez malgré tout sans être pleinement investi dans la thérapie, vous perdrez tous les deux un temps précieux.
Prenons l’exemple de « Jeanne », une femme d’une soixantaine d’années qui a consulté un thérapeute parce qu’elle ne parvenait pas à se remettre de la mort d’un animal domestique. Son thérapeute en ligne, une femme d’une trentaine d’années, traite Jeanne comme si elle était une mère qui souffre du syndrome du nid vide et qui devrait sortir davantage. « Pourtant, je ne me sens pas seule, affirme Jeanne, un esprit créatif, qui est heureuse en ménage, qui voit souvent ses enfants adultes et jouit d’un large cercle d’amis. Elle était très gentille, mais elle n’a pas du tout saisi qui j’étais. » Jeanne a eu l’impression d’être cantonnée dans un stéréotype, mais comme elle fuit les conflits, elle n’a pas su comment l’exprimer. Elle a fini par quitter sa thérapeute après plusieurs séances et n’en a pas cherché une autre. Finalement, elle a surmonté son chagrin toute seule, sans l’aide et la compréhension qu’elle espérait. Jeanne se demande encore si, avec le bon thérapeute, le processus aurait pu être plus court et moins douloureux.
Ainsi, même si ce n’est pas facile, si vous n’êtes pas satisfait pour quelque raison que ce soit, vous vous devez, à vous-même et à votre thérapeute, de communiquer vos sentiments et de mettre fin à la relation thérapeutique.
Bien commencer
Bien entendu, l’idéal est de trouver le bon thérapeute dès le départ. De nombreux thérapeutes énumèrent leurs spécialités et décrivent leur formation dans leur biographie en ligne, ce qui permet de réduire le champ de recherche et de choisir quelqu’un qui possède une expertise qui vous semble pertinente – quelqu’un qui a les atouts pour comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez besoin.
Selon Lindsey Thomson, psychothérapeute à Kanata, en Ontario, et directrice des affaires publiques de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, qui compte 13 000 membres dans tout le pays, il est important, au moment de choisir, « d’être très sincère quant à vos préférences. Disons que vous êtes une femme qui souhaite travailler sur un traumatisme passé, mais que vous êtes mal à l’aise d’en parler à un homme. Ou si vous faites partie d’une communauté marginalisée, vous pourriez vous sentir plus à l’aise avec quelqu’un qui a les mêmes origines culturelles que vous. Si vous avez de telles préférences, vous devez trouver quelqu’un qui y réponde », explique-t-elle. De nombreux thérapeutes, dont Mme Thomson, proposent une séance gratuite de 30 minutes pour aider les clients potentiels à tâter le terrain et à voir si la situation convient de part et d’autre.
En outre, il est essentiel de comprendre le type de thérapie proposé par le thérapeute et sa philosophie générale. Comme le souligne Mme Thomson, des études suggèrent que ce qui compte le plus est la dynamique entre le client et le thérapeute. « Il s’agit d’une relation de travail, souligne-t-elle, d’humain à humain. Si vous n’êtes pas d’accord avec quelque chose, ou si vous n’aimez pas la façon dont le thérapeute a formulé une question – ou si vous êtes acculé au mur et que vous n’étiez pas prêt pour cela – parlez-en. C’est très important. Oui, cela peut être inconfortable. Mais sachez que tous les thérapeutes veulent savoir ce que vous ressentez pendant ce processus. »
Il ne faut surtout pas disparaître subitement!
Comme l’explique Mme Thomson, bien que les situations thérapeutiques diffèrent, il faut compter environ 12 à 20 séances par client, en particulier lorsque l’approche est orientée vers un objectif, comme c’est le cas avec la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) .
« Disons que je vais consulter un psychologue parce que je souffre d’anxiété généralisée et que j’ai déjà suivi 10 séances. J’ai remarqué que je suis moins anxieuse, car j’ai réussi à modifier certains comportements. À ce stade, le thérapeute peut vérifier les progrès accomplis par rapport à mes objectifs de départ et voir comment j’ai réussi à mettre en pratique ces compétences – qu’il s’agisse de changements de comportement, de régulation des émotions ou de remise en question d’une pensée négative automatique afin de la laisser partir et de passer à autre chose. Je dois me demander si je suis certaine de pouvoir continuer à me débrouiller sans l’aide du thérapeute. » Du point de vue de Mme Thomson, au lieu de mettre fin à la thérapie, le thérapeute va proposer de modifier la fréquence des séances. « En général, je vois mes clients toutes les deux semaines. Pourquoi ne pas essayer de se voir une fois par mois pour ce que nous appelons une « thérapie d’entretien »? Si les compétences ne sont pas tout à fait bien intégrées, nous pourrons reprendre là où nous avions laissé.
À chaque étape du processus, la clé du succès est d’être à l’aise pour communiquer ses sentiments. Vous êtes là pour comprendre et acquérir les compétences qui vous permettront de grandir, de guérir et de faire face à la situation. Votre thérapeute doit être à vos côtés tout au long du processus.
S’il fait ou dit quelque chose de peu professionnel et que l’organisme auprès duquel il est inscrit est doté d’un code de déontologie et de mesures disciplinaires, vous pouvez déposer une plainte. Consultez les lois et règlements de votre province ou territoire pour connaître la procédure à suivre dans ce genre de situation.
Ressource : Fiche d’information :Idées reçues et mythes courants sur la santé mentale.
Autres lectures : Tisser des liens malgré les difficultés :L’ABC des soins de santé mentale pour les personnes ACN

Moira Farr
Journaliste, auteure et professeure primée, est diplômée de l’Université Ryerson et de l’Université de Toronto. Ses écrits ont été publiés notamment dans The Walrus, Canadian Geographic, Châtelaine et The Globe and Mail, et abordent des thèmes comme l’environnement, la santé mentale et les enjeux de genre. Outre l’enseignement et l’édition, elle travaille à son compte en tant qu’auteure, et a également été rédactrice universitaire dans le cadre du programme de journalisme littéraire du Banff Centre for Arts and Creativity.
Related Articles
Le modèle communautaire d’entraide de l’initiative Future Ready aide les gens à se dépasser et à s’épanouir.
Amina (nom fictif), jeune mère de quatre enfants, a été confrontée à de graves difficultés lorsqu’elle s’est séparée de son mari. Bien que résidant au Canada depuis plus de dix ans, elle était isolée chez elle, avec la crainte et le stress de devoir soudainement se débrouiller seule. Il lui fallait de toute urgence obtenir des services de counseling psychologique et de l’aide pour apprendre l’anglais, gérer ses transactions bancaires, faire ses courses et se repérer dans les transports en commun de la ville. « Son histoire est à la fois émouvante et inspirante », déclare Ramzia Ashrafi, responsable de l’équipe de pratique clinique de l’initiative Future Ready, qui a aidé des centaines de nouveaux arrivants partout au Canada depuis sa création, il y a deux ans, à préparer leur avenir.
L’équipe de Future Ready a mis Amina en contact avec des mentors, tant professionnels que bénévoles (également appelés « intervenants familiaux »), qui ont compris l’urgence de sa situation et ont rapidement mobilisé l’aide dont elle avait besoin. En quelques semaines, elle a pu bénéficier du counseling d’un praticien spécialiste des questions relatives aux personnes immigrantes et réfugiées. « Au bout d’environ huit ou neuf mois, elle se sentait très à l’aise de s’exprimer en anglais et, sans autre forme de soutien, elle avait trouvé une maison et un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins financiers et à ceux de ses enfants », explique Mme Ashrafi.
L’histoire d’Amina est l’une des nombreuses réussites de l’initiative, qui offre plusieurs programmes ciblant les jeunes, les familles et les personnes âgées ayant besoin d’un soutien en matière de santé mentale, d’éducation, d’intégration et d’emploi. « La communauté aide la communauté à bâtir sa résilience », explique Aleem Punja, responsable des opérations nationales de l’initiative Future Ready, dont les valeurs fondamentales sont l’autonomie individuelle, la dignité et l’équité.
Sans surprise, le nombre de personnes ayant besoin de son soutien a considérablement augmenté depuis que la pandémie a frappé, il y a trois ans.
« Cela n’a pas été facile, déclare M. Punja, mais nous faisons de notre mieux ». L’initiative Future Ready est une jeune organisation nationale qui compte 24 employés et 500 bénévoles communautaires partout au Canada, mais elle est pour autant en mesure de fournir un vaste éventail de services dont tant de personnes ont besoin.
L’énergie positive générée par tous les participants à l’initiative Future Ready se reflète dans l’exposition virtuelle Journey Upstream, une émouvante vitrine d’art, de photographies, de musique, de poésie parlée, de graphiques et de témoignages illustrant les expériences, les espoirs et les rêves des nouveaux arrivants au Canada qui cherchent à tisser des liens avec la communauté. La description de l’exposition indique qu’elle « vise à raconter, à travers des perspectives variées et uniques, la manière dont l’initiative Future Ready nourrit l’espoir et consolide la résilience, tout en dotant les familles et les individus de ressources qui leur permettent de surmonter les difficultés et de s’épanouir avec assurance ». La priorité accordée à la santé mentale est parfaitement illustrée par l’une des photographies : une clôture grillagée sur laquelle figurent trois simples affiches, où il est inscrit en noir et blanc VOUS COMPTEZ, VOUS N’ÊTES PAS SEUL(E), N’ABANDONNEZ PAS.
L’équipe multidisciplinaire de gestion des cas de santé mentale de l’initiative Future Ready comprend des travailleurs sociaux, du personnel infirmier et des psychothérapeutes spécialement formés dans des domaines aussi essentiels que la prévention du suicide, les dépendances, le deuil et le trouble de stress post-traumatique. Il est particulièrement important d’offrir des soins tenant compte des traumatismes aux personnes qui fuient les guerres et les persécutions, explique M. Punja. Pour ce faire, il faut établir des partenariats avec de nombreux organismes apparentés, comme ABRAR Trauma and Mental Health, qui peuvent offrir un soutien opportun, virtuellement ou en personne. Qu’il s’agisse de la perte d’êtres chers en raison de la COVID-19, de problèmes de santé mentale et physique liés à la pandémie ou de la désorganisation des revenus et de l’éducation provoquée par la maladie, la guerre, l’intégration ou les bouleversements politiques, toutes ces situations ont eu une incidence sociale considérable sur les individus et les familles.
Pour certains, le fait de demander de l’aide est encore perçu comme quelque chose de tabou, explique M. Punja. Admettre que l’on a du mal à trouver un emploi, à payer ses factures ou à nourrir sa famille est déjà très stressant, mais, si on fait face à ces problèmes en solitaire, ils peuvent sembler impossibles à surmonter. Pour que les gens puissent plus facilement demander et recevoir de l’aide, il faut établir avec eux un lien qui leur fera comprendre que tout le monde a des difficultés à affronter et que chaque personne a intérêt à aider son prochain. « Peut-être qu’un cousin peut vous aider à apprendre l’anglais ou qu’un voisin peut s’occuper de vos impôts », illustre-t-il. Changer le langage et la dynamique entre l’aidé et l’aidant permet également de rendre moins stigmatisant le fait d’aider quelqu’un à se remettre sur pied. Nous ne parlons pas de pauvreté, mais plutôt de vulnérabilité.
Il convient par ailleurs de se centrer sur les objectifs : une personne ou une famille peut traverser une période difficile, mais en les aidant à se projeter vers des jours meilleurs, l’initiative Future Ready met l’accent sur l’autonomie et la résilience des personnes, afin qu’elles puissent définir de façon autonome les stratégies les plus adaptées à leur réussite.
En outre, aider les gens à être « prêts pour l’avenir » signifie privilégier les relations au sein de la communauté, indispensables à la santé mentale (en complément des interventions directes comme le counseling et l’encadrement). Les événements rassembleurs, comme les spectacles de musique, les expositions d’art, les sports et les activités conçues spécialement pour les jeunes, les familles ou les personnes âgées, contribuent à l’intégration des nouveaux arrivants et les aident à rester positifs et optimistes en dépit des épreuves et des obstacles.
Le Rapport sur les retombées 2022 de l’initiative Future Ready fait état d’un certain nombre de jalons positifs pour l’organisation. « Depuis sa création en 2021, Future Ready a apporté un soutien complet et personnalisé dans les domaines du mentorat familial, de l’avenir professionnel, de la santé mentale, de l’excellence en matière d’intégration et du mentorat des jeunes à plus de 727 personnes. » Son action a permis de consacrer 560 heures de services à des personnes présentant des risques sur le plan de la santé mentale. Ceci consistait notamment à aider les personnes inscrites sur de longues listes d’attente à trouver des soins auprès d’un médecin – spécialisé en santé mentale ou en soins primaires – et à soutenir les membres de la famille qui s’inquiétaient de la santé mentale d’un proche. Future Ready a également aidé plus de 100 intervenants familiaux et mentors « à gérer avec compétence des situations délicates tout en évitant l’épuisement professionnel. »
Ali Masroor Bigzad, qui a émigré d’Afghanistan avec sa famille en septembre 2021 et vit actuellement à Sherbrooke, a qualifié sa participation à l’exposition Journey Upstream d’étincelle d’espoir. C’est l’initiative Future Ready qui lui a insufflé cet élan d’espoir. « À notre arrivée, le représentant de Future Ready est venu nous souhaiter la bienvenue au nom des dirigeants de la communauté et nous a demandé si nous avions besoin de quoi que ce soit. Nous étions tous très heureux de la présence de ces institutions, qui ont ravivé en nous l’espoir d’un avenir meilleur. Le personnel a soutenu notre intégration de différentes manières. Surtout, le représentant de l’initiative Future Ready m’a donné des conseils quant aux différentes options d’études que je pouvais suivre. Sans lui, il m’aurait été difficile de m’orienter efficacement dans l’amorce de mon parcours pédagogique. »
Le personnel de Future Ready, les intervenants familiaux et les mentors ont bien l’intention de poursuivre l’initiative afin que chaque membre de la communauté puisse s’épanouir tout au long de son parcours en bénéficiant des meilleurs services et de l’espoir qu’ils suscitent.

Fateema Sayani
Une habituée des organismes à vocation sociale, ainsi que des salles de presse, où elle a passé plus de 20 ans aux commandes de nombreuses activités, de la stratégie à la collecte de fonds. Ses écrits, qui couvrent une foule de sujets allant des politiques à la culture populaire, sont parus dans des publications de premier plan à la grandeur du Canada et lui ont valu des prix pour ses reportages sur la justice sociale. Forte de ses diplômes, de ses certificats et de ses activités bénévoles, elle s’est donné pour mission de changer l’image des communautés sous-représentées. Malgré son horaire chargé, elle trouve encore le temps de se plonger dans la scène musicale canadienne.
Related Articles
Au Canada, les personnes âgées qui vieillissent sans aucun soutien sont de plus en plus nombreuses. Comment pouvons-nous endiguer ce phénomène? Un regard sur le vieillissement inclusif à l’occasion de la Semaine de sensibilisation à la solitude
« Pourquoi, se demandait-elle, était-il si difficile de croire que les vieux avaient été jeunes, avec la force et la beauté animale de la jeunesse, qu’ils avaient aimé, été aimés, ri et été pleins de l’optimisme non prémédité de la jeunesse? » – PD James —
L’hiver dernier, mes voisins ont trouvé l’une de nos résidentes âgées en train d’errer dans le couloir de la buanderie de notre immeuble. Elle semblait perdue et désorientée.
Nous avons fini par appeler une ambulance, car, de toute évidence, elle n’allait pas bien. Elle vivait en face de chez moi, mais je ne la connaissais pas vraiment. Ce jour-là, après une brève évaluation par téléphone, le répartiteur nous a dit qu’il faudrait attendre quatre heures. Comme il n’y avait rien à manger dans son réfrigérateur, certains d’entre nous ont apporté des en-cas et lui ont préparé quelques tasses de thé en attendant l’ambulance autour de la table de cuisine. Quand elle nous a dit qu’elle avait 91 ans et qu’elle vivait seule, nous lui avons demandé qui nous pourrions appeler. Ce n’est qu’après quelques heures de conversation qu’elle nous a dit qu’elle n’avait ni enfant, ni frère ou sœur. Elle avait un neveu, mais qui vivait à des centaines de kilomètres et qui a été surpris lorsque nous l’avons appelé, disant qu’il n’avait pas parlé à sa tante depuis des années.
Les événements de ce jour de janvier ont marqué un tournant dans la vie de ma voisine, mais aussi dans la mienne. Elle n’est pas rentrée chez elle depuis son admission à l’hôpital. Je ne sais pas ce qu’elle est devenue et je ne le saurai jamais, car je ne fais pas partie de sa famille. Pourtant, plus tard dans la soirée, je n’ai pas pu m’empêcher de me demander si l’avenir me réservait le même sort.
Deuils et vieillissement
Quand on vieillit, on risque de faire face à une série de deuils : on peut perdre des proches, des réseaux sociaux, le bien-être physique, la sécurité financière, la motivation, le sentiment d’appartenance à un monde plus vaste et même le sens de son identité personnelle. Ce sont des pertes importantes qui « remettent profondément en question notre appartenance au monde qui nous entoure », explique Sam Carr, Ph. D., chercheur principal du « Projet solitude » (The Loneliness Project), une étude qualitative qui explore en profondeur l’expérience de la solitude chez les personnes âgées. Nombre de répondants ont expliqué aux chercheurs que le vieillissement présente des difficultés uniques liées à la solitude et l’isolement. La recherche, dont les résultats sont publiés dans Ageing and Society, a produit plus de 130 heures de conversations. Le témoignage de l’une des participantes ayant perdu son conjoint montre l’ampleur de ces deuils : « Quand il est parti, j’étais perdue. Je ne savais plus qui j’étais, car je n’étais pas [bouleversée]. J’existais, c’est tout. J’allais faire des courses quand j’avais besoin de nourriture. Je ne voulais voir personne. Je n’allais nulle part. »
Dans le cadre d’une étude sur la perte de liens significatifs chez les personnes âgées, des chercheurs de l’Université de Malmö, en Suède, ont conclu que la solitude profonde vécue à un âge avancé peut être considérée comme « un processus où la personne se détache de la vie ». Le corps participe aussi à cette expérience dans la mesure où la personne âgée est de plus en plus limitée dans ses mouvements. Petit à petit, elle fait le deuil de ses relations à long terme, puis elle se replie de plus en plus sur elle-même et se détourne du monde extérieur.
Vieillir sans le soutien de proches
Au Canada, le nombre de personnes qui vieillissent sans soutien va également en augmentant. Ces adultes d’âge mûr n’ont pas de proches parents, donc, pas de conjointe ou de conjoint et pas d’enfants (ou alors les enfants vivent loin). D’autres ont une famille, mais sont tout de même isolés. Même si la majorité de ces personnes veulent vieillir chez elles, elles sont parfois obligées d’intégrer des centres de soins de longue durée. Le Canada affiche déjà l’un des taux les plus élevés au monde de personnes sans famille. Comment s’y prendra-t-il pour soutenir ces personnes et s’occuper d’elles?
Au Royaume-Uni, la question est liée à un thème plus vaste : la solitude, une menace croissante pour la santé. En 2018, la première ministre Theresa May l’a qualifiée de « l’un des plus grands problèmes de santé publique de notre époque » lorsqu’elle a créé le « premier ministère au monde » chargé de lutter contre la solitude. Début 2021, le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, lui a emboîté le pas et a créé le poste de ministre de la Solitude au sein de son cabinet. Le premier titulaire de ce poste, Tetsushi Sakamoto, a été chargé de prévenir et de réduire la solitude généralisée, l’isolement social et le suicide, qui allaient en augmentant dans le contexte des restrictions liées à la COVID-19.
Ces mesures s’appuient sur des données probantes démontrant les risques que pose la solitude pour la santé et la santé mentale. Selon Keith Dobson, Ph. D., professeur de psychologie clinique à l’Université de Calgary, « la recherche a toujours montré qu’à tous les âges, un faible soutien social ou un isolement social accru est l’un des principaux facteurs de risque de dépression ». Aux États-Unis, le National Institute on Aging associe la solitude et l’isolement à un « mauvais état de santé avec le vieillissement », notamment à des taux plus élevés de mortalité, de dépression et de déclin cognitif.
L’isolement dont souffrent un grand nombre de personnes s’accompagne aussi d’un fardeau économique. Aux États-Unis, depuis des décennies, le nombre de personnes seules a atteint un point tel que dans la population active, « plus de deux adultes sur trois déclarent vivre dans la solitude » – ce qui est à l’origine de problèmes de santé, de baisses de productivité et d’une rotation du personnel qui coûtent quelque 154 milliards de dollars par année aux employeurs. En Angleterre, 45 % des adultes souffrent d’un certain degré de solitude, ce qui coûte aux employeurs britanniques environ 2,5 milliards de livres sterling (4,2 milliards de dollars canadiens) par année, selon un rapport de la New Economics Foundation publié en 2017. Ces données brossent un tableau désastreux, surtout si l’on considère qu’elles proviennent en grande partie de recherches menées avant la pandémie.
Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne
Comme on peut s’y attendre, tout le monde ne vit pas les contrecoups de la solitude et de l’isolement de la même façon. Les organismes caritatifs qui soutiennent les personnes âgées sont les premiers à constater que certaines personnes sont plus touchées par une accumulation de difficultés existentielles. Selon Gregor Sneddon, directeur général de l’organisme basé à Ottawa Aide aux aînés Canada, nous savons que « lorsque les personnes vieillissent et vivent des déficiences physiques et cognitives, elles fréquentent moins le monde et les gens, et elles souffrent des séquelles de l’isolement. Ajoutez à cela une pandémie mondiale qui a forcé les gens à se cloîtrer chez eux, les a empêchés de participer à la vie communautaire et de cultiver un sentiment d’appartenance, les a coupés de leur famille et de leurs amis… et vous obtiendrez un résultat assez médiocre en matière de santé. » Mais la situation est sans aucun doute bien « pire pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent […] Ceux qui n’ont aucun choix sont les plus exposés à la solitude, qui, nous le savons, peut être fatale. »
Le Canada a-t-il besoin d’un ministre de la Solitude?
Bill VanGorder, responsable par intérim des politiques de l’Association canadienne des individus retraités (CARP), sait que « la solitude et l’isolement ne touchent pas seulement les personnes que l’on peut considérer comme âgées ». Mais il est tout à fait favorable à la création d’un poste de ministre de la Solitude au Canada « si c’est ce qu’il faut pour remédier aux effets de la solitude et de l’isolement sur les Canadiens. Un ministre veillerait à ce que des programmes soient mis en place pour atténuer ces problèmes, d’autres secteurs du gouvernement lui rendraient des comptes et peut-être, enfin, pourrions-nous changer la façon dont nous nous occupons des personnes âgées au Canada ». Dans des sociétés comme la nôtre, qui prônent l’indépendance et l’individualisme, nous avons tendance à laisser les gens régler et gérer leurs propres problèmes. Mais si vous êtes malade, isolé et sans soutien, c’est beaucoup plus difficile à faire.
Le gouvernement britannique aborde cette question de manière intégrée et reconnaît qu’il reste beaucoup à faire et que chacun doit jouer un rôle. Pour mettre en place un réseau de soutien, il faut pouvoir compter sur le gouvernement ainsi que sur les amis, la famille, les employeurs, les secteurs bénévole et communautaire, les autorités régionales et les organismes de santé publique. Mais ce n’est qu’un début. La stratégie britannique de lutte contre la solitude est guidée par un cadre visant à améliorer et à relier les services sociaux, à réinventer les espaces communautaires, le transport, le logement, la technologie, les approches holistiques de la santé et les campagnes de santé publique visant à sensibiliser et à réduire la stigmatisation liée à la solitude. La campagne lancée en 2019 par le gouvernement, Let’s Talk Loneliness (Parlons de la solitude), en est un exemple : elle souligne l’importance de parler de la solitude tout en dénonçant la stigmatisation qui l’entoure.
La prescription sociale fait même partie du programme; c’est-à-dire que des coordonnateurs communautaires, des conseillers en santé et bien-être et des navigateurs communautaires répondent aux besoins non cliniques (y compris ceux des personnes qui se sentent seules) en mettant les gens en contact avec des groupes et des services communautaires leur procurant un soutien pratique et émotionnel.
L’approche intégrée adoptée par le Royaume-Uni n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation, mais elle repose sur des principes qui relèvent du bon sens et qui semblent bien plus solides que les soutiens fragmentés et décousus que l’on connaît au Canada. Bien qu’il existe chez nous aussi des ressources et des programmes, ils peuvent être difficiles à trouver, surtout si une personne est isolée et n’a pas accès à Internet. Et pourtant, le principe ne pourrait être plus simple : la société a tout à gagner quand elle veille au bien-être des personnes âgées et de leurs familles. Cela vaut également pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique ou un handicap. Une société véritablement inclusive profite à tous.
Quelle forme prendra le vieillissement inclusif et sain dans notre pays ? Est-ce que notre société reconnaîtra la valeur des personnes âgées ainsi que l’utilité et la dignité de tous, et mettra-t-elle de côté les préjugés et la discrimination fondée sur la capacité? Je nourris l’espoir d’une nouvelle vision du vieillissement solidaire et inclusif, qui nous amènera à « créer des lieux de vie et des collectivités qui intègrent ces mécanismes de soutien ».
Ressources disponibles au Canada :
- Aide aux aînés Canada
- Programmes et services pour les aînés du gouvernement du Canada
- Transformer le portrait des soins de santé, des services sociaux et des services communautaires pour optimiser la santé mentale des personnes âgées au Canada
- Mieux soutenir la santé mentale des personnes âgées au Canada
- Résumé : Lignes directrices relatives à la planification et à la prestation de services complets de santé mentale pour les aînés canadiens
- Le Recueil de pratiques exemplaires pour améliorer la santé mentale des aînés au Canada
- Soutenir les aînés : Utiliser des principes et des valeurs pour promouvoir les pratiques exemplaires
- Application des Lignes directrices relatives à la planification et à la prestation de services complets en santé mentale pour les aînés canadiens en période de COVID-19

Nicole Chevrier
Passionnée de santé mentale, elle est aussi une écrivaine enthousiaste et une photographe de talent. Nicole a récemment publié son premier livre, qui s’adresse aux enfants vivant de l’intimidation. Quand elle n’est pas à son bureau, elle partage ses temps libres entre le yoga, la méditation, la danse de salon, la randonnée pédestre et la photographie des merveilles de la nature. Elle collectionne aussi les couchers de soleil.