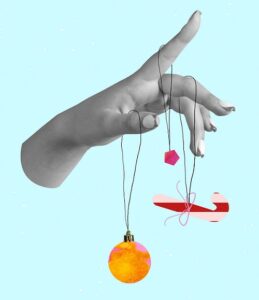Restez à l’affût!
Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!
Related Articles
Le Black Dog Institute d’Australie allie recherche et esprit communautaire. Une conversation sur la sensibilisation, l’équilibre et l’art de mettre « le sérieux en avant, et la fête en arrière ».
Si vous avez l’occasion de visiter Sydney en septembre, vous remarquerez peut-être quelque chose de surprenant : un grand nombre de personnes arborant la coupe mulet.
En effet, chaque année, le Black Dog Institute (BDI) organise sa campagne Mullets for Mental Health, où les Australiens sont encouragés à se laisser pousser les cheveux dans ce style tant décrié jusqu’à la période de collecte de fonds. Les personnes gagnantes, c’est-à-dire celles dont la crinière rapporte le plus d’argent, peuvent également remporter des récompenses, notamment le très convoité chapeau à perruque nuquette.
La coupe mulet est un moyen facile de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour la recherche sur la santé mentale, à l’instar de la campagne canadienne Movember, qui met la moustache à l’honneur au profit de la santé mentale et physique des hommes.
Pour Helen Christensen, qui a été directrice de l’Institut BDI pendant près de dix ans, des campagnes comme celle-ci sont doublement bénéfiques. « Nous nous sommes forgé une réputation au sein de la communauté », affirme-t-elle. « Les gens sont plus susceptibles de s’impliquer parce qu’ils savent qui nous sommes, ce qui rend notre organisation plus durable. »
Le Black Dog Institute, dont le nom renvoie à l’expression « mon chien noir », employée par Winston Churchill pour décrire sa dépression, est le seul institut de recherche médicale en Australie à étudier la santé mentale tout au long de la vie. Avant que Mme Christensen rejoigne l’institut BDI en 2012, celui-ci effectuait déjà un travail innovant, principalement en réalisant des études sur la dépression résistante au traitement, tout en informant les cliniciens et autres chercheurs de ces résultats, même si cette approche était relativement inconnue en dehors de la communauté psychiatrique.
Forte de son expérience en matière d’études auprès de la population, Mme Christensen s’est efforcée de sortir la recherche des murs des hôpitaux pour l’ancrer dans la communauté. Elle a notamment contribué à opérer une réorientation stratégique vers des études communautaires et longitudinales à plus grande échelle qui sont réalisées au moyen d’Internet et axées sur les technologies. Plutôt que de se concentrer sur les cliniciens, l’Institut BDI a également commencé à proposer des formations dans les écoles et des cours destinés aux gestionnaires dans les milieux de travail.
Même si la recherche reste au cœur du travail « sérieux » de l’Institut BDI, ce sont maintenant ses événements communautaires qui le font avancer. C’est là où commence la « fête en arrière ».
Les campagnes communautaires donnent un côté ludique à la collecte de fonds, tout en rappelant aux Australiens que nul n’est à l’abri de la maladie mentale. Elles s’articulent autour d’activités qui favorisent la convivialité, comme les courses, les parcours d’obstacles et d’autres idées proposées par les membres de la communauté.
Donner la parole aux personnes ayant un savoir expérientiel
L’Institut BDI s’engage également à intégrer le vécu des personnes ayant un savoir expérientiel passé ou présent des problèmes de santé mentale. Appelée à commenter la croissance de ce domaine d’expertise, Mme Christensen explique qu’il s’agissait au départ d’un groupe consultatif formé à la suite d’un appel de propositions ouvert (un peu comme le Groupe couloir et le Conseil des jeunes de la Commission de la santé mentale du Canada), qui a évolué pour devenir une division spécialisée de l’Institut.
« Depuis le début, nous prenons en compte les connaissances des personnes ayant un savoir expérientiel des problèmes liés à la santé mentale, mais nous avons aussi reconnu que nous devions structurer l’intégration de cette expertise dans le reste des activités de l’organisation, déclare-t-elle. « Il fallait un cadre, des processus, un personnel, un réseau et des bénévoles dédiés à cette expertise. Une partie du cadre est encore en voie d’émergence, mais ce sont les personnes ayant un savoir expérientiel elles-mêmes qui dirigent ce processus. »

Black Dog Institute
De même, l’Institut fait appel à l’expertise des personnes autochtones d’Australie ayant un savoir expérientiel. Grâce à son Centre d’expertise des personnes autochtones ayant un savoir expérientiel, l’Institut BDI s’investit dans des domaines tels que la recherche et la gestion de projets. Mais comme l’indique Mme Christensen, « il ne suffit pas de dire : Nous voulons améliorer la santé mentale des Autochtones, mettons donc en place un programme ».
Nous sommes les représentants d’une organisation et d’un mouvement, mais nous n’en sommes pas le moteur et nous ne pouvons pas agir à leur place, souligne-t-elle. « Quand on a la chance d’être une organisation respectée en laquelle les gens ont confiance et qui cadre avec leur travail, alors on peut aider, à condition d’y être d’abord invité. » À mesure que cette approche ciblée a gagné en importance, les partenaires autochtones sont devenus une pierre angulaire de l’Institut.
Prévention et progrès
Bien que Mme Christensen ait quitté ses fonctions de directrice de l’Institut BDI en 2021, elle reste très engagée dans l’amélioration de la santé mentale et dans les initiatives qui visent à sauver des vies partout en Australie. Elle continue à lutter contre le statu quo en se consacrant particulièrement à la prévention du suicide dans le cadre de ses fonctions actuelles à titre de professeure en santé mentale à l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud et d’administratrice non dirigeante du conseil d’administration de l’Institut BDI.
La prévention du suicide n’a rien de nouveau à l’Institut BDI, qui offre une vaste gamme de recherches et de ressources dans ce domaine. Toutefois, selon Mme Christensen, il manque encore une pièce essentielle du casse-tête : les données.
« C’est comme essayer de travailler les yeux bandés. L’absence de données concrètes entraîne beaucoup de désinformation et de catastrophisme », soutient-elle, ajoutant qu’il n’existe tout simplement pas de statistiques précises sur l’automutilation et les tentatives de suicide.
À titre d’exemple, Mme Christensen raconte l’histoire d’une étudiante qui a fait une tentative de surdose en prenant une quantité excessive de pilules. « À son réveil le lendemain matin, elle se sentait physiquement bien, alors elle s’est habillée et est allée à l’université comme si de rien n’était. Cette tentative n’a été consignée nulle part. Combien de fois ce genre de scénario se produit-il? On ne le sait pas. »
Pour aider à combler ces lacunes en matière de données, elle prône l’apprentissage auprès d’autres secteurs. « Les concessionnaires automobiles disposent de toutes sortes de données pour améliorer leurs affaires. Les applications bancaires consultent des indicateurs pour déterminer précisément quels investissements sont rentables et lesquels ne le sont pas. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose pour améliorer la prévention du suicide? »
Tirer parti des outils numériques
Lorsque la COVID-19 a forcé les gens à rester chez eux, des services de santé de toutes sortes sont passés au mode virtuel, y compris les soins de santé mentale. Aujourd’hui, l’Institut BDI continue de miser sur les outils et ressources numériques de santé mentale fondés sur des données probantes et d’étudier l’efficacité des applications. Parallèlement, les Australiens peuvent demander gratuitement des services de counselling, du soutien par les pairs et d’autres services de télésanté par l’intermédiaire de l’Institut.
Si l’afflux d’outils de télésanté a rendu les options de traitement plus accessibles pour bien des gens, Mme Christensen rappelle qu’ils ne sont toutefois pas une panacée. « Les services autonomes que nous pouvons désormais offrir virtuellement n’ont pas été intégrés à notre système de santé global, explique-t-elle. Sans un dossier de santé intégré permettant au fournisseur de soins de faire le suivi, il n’y a aucun moyen de confirmer si l’état de la personne s’améliore réellement après un traitement. C’est un problème majeur. »
Pour Mme Christensen, ce virage numérique offre une occasion sans précédent de remanier un système souvent incohérent. « J’aimerais voir une vraie intégration : un modèle de soins qui inclut les services de santé virtuels doublé d’une plateforme technologique capable de les offrir. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous verrons un véritable modèle de soins collaboratifs et axés sur le patient. »
Malgré les lacunes actuelles en matière de données et d’accès aux soins, Mme Christensen garde l’espoir que les outils et la collecte de données numériques recèlent un grand potentiel, notamment pour la prévention du suicide. « Prenons l’exemple du cancer et des maladies infectieuses. Des changements impressionnants dans la façon de traiter les patients ont été constatés au cours des 40 dernières années. La prévention du suicide, en revanche, est encore un domaine jeune. »
« En recueillant davantage de données pour améliorer les résultats, en renforçant notre capacité à fournir des soins intégrés et en mettant l’accent sur les déterminants sociaux de santé, je crois que nous pouvons vraiment accélérer la cadence en ce qui concerne la santé mentale. »
Ressources
Karla est la vice-présidente des programmes et des priorités à la CSMC.
Related Articles
Après le meurtre de George Floyd et d’autres actes de racisme et de discrimination à l’encontre des Noirs, de nombreuses personnes d’origine africaine, caribéenne et Noire (ACN) se sont manifestées – en ligne, dans les médias et dans la rue – pour réclamer justice et changement. Mais pour certains, porter le flambeau devient lourd, car les mouvements évoluent et que les injustices perdurent. Trouver le militantisme qui convient à votre situation.
L’un des premiers souvenirs de Melicia Sutherland remonte au jour où un enseignant l’a traitée du « mot en N ». Elle était en deuxième année.
J’étais dehors pendant la récréation, et je me souviens que l’enseignant a dit : « Tout le monde rentre maintenant. Les élèves rentraient dans l’école par les grandes portes et j’étais la suivante dans la file. L’enseignant a claqué la porte devant moi et m’a traitée du « mot en N ». Je ne savais pas ce que signifiait ce mot. J’avais seulement l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. Sinon, pourquoi cet adulte m’aurait-il fermé la porte au nez alors qu’il avait laissé rentrer tous les autres? ».
Sutherland se souvient avoir ressenti toute une gamme d’émotions en rentrant de l’école : colère, gêne, honte. Mais plus tard, elle est devenue curieuse après avoir demandé à sa mère ce qu’elle pensait que l’enseignant avait voulu dire. « Ma mère a répondu qu’elle ne savait pas, et nous avons laissé tomber ».
Devenir l’autre
Si seulement c’était aussi simple. Après cet incident avec l’enseignant, elle s’est rendu compte qu’elle avait ressenti un peu la même chose à la maternelle, lorsqu’elle s’était sentie à part des autres enfants, aussi bien physiquement et psychologiquement.
C’était en 1989 quand, à l’âge de cinq ans, sa famille et elle ont quitté Montego Bay, en Jamaïque, pour s’installer à North York, dans la banlieue de Toronto. Immédiatement, et pour la première fois, elle a eu le sentiment d’être « une autre ».
« Les enseignants me sortaient de la classe et jouaient avec mes cheveux pendant que les autres enfants apprenaient l’alphabet, raconte-t-elle. J’ai toujours été comme cette petite poupée Noire avec laquelle les personnes non Noires voulaient jouer ».
À force de vivre avec la discrimination et de se faire traiter différemment des autres, Sutherland a fini par se rendre compte que la société devait changer. « En vieillissant, alors que je tentais de créer et de maintenir un certain caractère et un système de valeurs pour moi-même, il m’est apparu clairement que je devais devenir une militante », explique-t-elle. À l’été 2020, Melicia s’est jointe à la marche organisée par Remember The 400 motivée par la quête de justice pour le meurtre de George Floyd.
Elle n’a toujours pas vu la séquence vidéo de près de 10 minutes montrant comment George Floyd a perdu la vie des mains (ou plutôt des genoux) d’un policier. Pour protéger sa santé mentale, Sutherland s’est protégée des médias qui ressassaient l’incident jour et nuit. « J’étais bombardée d’images et les gens m’envoyaient des vidéos. Je ne veux pas voir quelqu’un mourir, ça blesse mon âme. Je me suis retirée des médias sociaux, car ce n’est pas bon pour ma santé mentale », souligne-t-elle.
Mais elle précise que le fait de prendre soin d’elle-même ne diminue en rien son activisme.
« Je me protège. Je n’aime pas ce genre de chose, car ça devient du sensationnalisme. Les gens veulent voir ce type d’images, c’est du voyeurisme et ça ne m’intéresse pas. Alors non, je n’ai jamais visionné la vidéo, mais je voulais faire partie de quelque chose qui allait apporter un changement significatif ».
Et, bien que traumatisante, la réponse à la violence contre les Noirs – vue, entendue et ressentie dans les médias et au sein des communautés ACN – a aussi contribué à changer les choses. Selon une étude (en anglais) de l’Académie nationale des sciences évaluée par des pairs, les manifestations du mouvement Black Lives Matter (BLM) ont élargi le débat public sur les sujets antiracistes.
Comme l’a montré la recherche, les manifestations ont marqué une première étape importante pour créer un changement social et un tournant dans la manière dont les gens perçoivent le racisme. Les manifestations ont également contribué à redéfinir la manière dont les gens vont chercher et consomment l’information au sujet des communautés Noires, alors qu’ils cherchent à concilier les questions de race et de violence policière. En outre, l’étude a montré comment les personnes se manifestent et trouvent une forme de militantisme qui leur correspond pour lutter contre les inégalités raciales.
Le militantisme n’est pas la solution universelle. Militer, c’est agir, mais pas forcément de façon frontale, voire dynamique. Il ne s’agit pas toujours de manifester dans les rues, ou de scander des appels aux changements en agitant des pancartes.
Le militantisme de Sutherland passe plutôt par les arts, par les mots, par le langage, par les images – et même par la coiffure. « Il ne s’agit pas seulement d’aller manifester, explique-t-elle. Ce qui change les choses, c’est d’agir sur le terrain. C’est ce que vous faites dans votre communauté immédiate, dans votre famille, avec vos amis et vos voisins ».
Se désengager pour se réengager
Nicole Franklin, travailleuse sociale agréée, psychothérapeute, directrice clinique et fondatrice de Live Free Counselling and Consulting Services à Toronto, est du même avis. Depuis 2017, son organisme – dirigé par des Noirs et appartenant à des Noirs – a contribué à combler le manque de thérapeutes Noirs dans les communautés racialisées. Il a également fourni une éducation et une formation en matière de santé mentale des Noirs. Pour Franklin, la « résistance des Noirs » est faite de gestes quotidiens allant contre la suprématie blanche et le colonialisme qui, au sein des systèmes politiques, économiques et sociaux, poussent les communautés ACN en marge de la société. Cette résistance est diverse et peut prendre de nombreuses formes, que ce soit dans les salles de classe, dans les salles de réunion ou dans la rue. « Les Noirs prennent soin d’eux-mêmes par la joie, l’art, la danse, la transmission de recettes – même la cuisine peut être un geste qui permet de prendre soin de soi et de sa communauté, explique-t-elle. C’est le genre de choses dont nous ne parlons pas assez ».
Si la résistance a bien des visages, Franklin s’empresse de préciser qu’elle peut devenir improductive quand elle est continue. « Nous ne devrions pas toujours avoir à résister en tant que Noirs. Nous avons aussi le droit « d’être » tout simplement. Il faut parfois se désengager ou se retirer pour reprendre contact avec soi et avec la communauté. Le militantisme, c’est aussi savoir quand arrêter pour se reposer. Demandez-vous ce qui vous apporte de la joie? Qu’est-ce qui stimule votre créativité? Tout être humain naît avec le droit de se projeter ailleurs que dans un système oppressif et d’avoir des espaces sûrs pour s’épanouir plutôt que de se concentrer sur la survie », poursuit-elle.
« Quand on est Noir, on peut avoir l’impression que l’on doit absolument se faire le porte-parole de Black Lives Matter ou de mouvements semblables pour se porter à la défense de la communauté Noire. Mais la communauté Noire n’est pas un bloc monolithique, et ce n’est à nous d’enseigner à nos collègues, à nos pairs et à d’autres personnes lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité, prêts ou capables d’engager ce genre de conversation. (En plus, nous sommes fatigués!). Pour réagir, chacune et chacun a besoin de se sentir en lieu sûr et il ne faut pas non plus oublier de célébrer l’excellence et l’avenir des Noirs ».

Melicia Sutherland
Pour Sutherland, cela signifie embrasser avec authenticité et sans honte la liberté d’explorer son identité, notamment « sa peau foncée, ses cheveux crépus, ses lèvres épaisses, ses yeux en amande et ses joues pleines ». Cela dit, le militantisme qu’elle pratique dans sa communauté de l’est de Toronto – qui comprend l’animation de programmes de leadership et de programmes de lutte contre la violence – soutient toutes les nuances et couleurs, et pas seulement les Noirs.
« Les gens disent toujours : « Oh, Mel, tu es tellement pro-Noir ». Je ne veux pas porter le fardeau de représenter ma race! Ce n’est pas parce qu’on a la même couleur de peau qu’on se ressemble…et je dis cela avec toute la bienveillance du monde », précise-t-elle. « Bon nombre d’entre nous sont Noirs sans pour autant avoir les mêmes valeurs, les mêmes idéaux ou les mêmes objectifs. Je ne veux pas avoir l’impression de représenter toute ma race. Je ne suis pas pour la suprématie des Noirs. Je ne supporte pas la suprématie blanche, alors pourquoi soutiendrais-je la suprématie Noire? C’est étrange, non? Penser que l’on vaut mieux que les autres, pour moi, est étrange ».
L’un des objectifs de Franklin, comme thérapeute et intervenante pour le bien-être communautaire, c’est d’aider ses patientes et patients Noirs à surmonter leur expérience du racisme et des traumatismes raciaux en les aidant à mettre au point des plans d’action, mais aussi en validant leurs sentiments et en leur disant qu’ils ne sont pas seuls. Mais elle ne veut pas entendre parler du fait que les Noirs devraient porter le fardeau du racisme contre les Noirs au nom de la race tout entière.
« Le racisme, qui est souvent internalisé, a un effet sur notre santé mentale; on devrait l’aborder comme un problème systémique et non comme un défaut personnel. Je ne crois pas qu’il soit toujours de notre responsabilité de sortir dans les rues ou sur Internet pour éduquer les gens en permanence, ajoute-t-elle. Parfois, tout ce que l’on peut faire, c’est simplement être. Le repos, c’est aussi un acte de résistance ».
Tout comme il y a une diversité de Noirs au Canada, il existe de nombreuses façons pour une personne Noire de décider comment elle va militer, et comment elle va prendre soin d’elle-même et s’occuper de sa communauté. Les événements accablants, traumatisants et tragiques relatés dans les médias au sujet du racisme contre les Noirs nécessitent une transformation radicale et ne peuvent reposer durablement et équitablement sur les épaules de personnes sous prétexte qu’elles sont Noires.
Militez tout en respectant là où vous en êtes
Angelique Benois, infirmière en santé mentale de pratique avancée, psychothérapeute, consultante en bien-être mental et directrice de Nurturing Our Wellbeing, recommande à la communauté ACN de trouver un équilibre entre la nécessité de rester informé et le danger d’ingurgiter trop de nouvelles sur la violence contre les Noirs.
« Je conseille vivement aux gens d’être prudents quand ils s’informent sur l’actualité mondiale ou écoutent les derniers bulletins de nouvelles, explique-t-elle. Comme nous sommes chaque jour bombardés de nouvelles qui peuvent nous bouleverser, nous devons prendre des mesures chaque jour pour protéger notre santé mentale, et il faut intégrer ces mesures à notre mode de vie ».
Pour ce qui est de la façon dont notre esprit et notre corps traitent ces images, pour ensuite s’en détacher, « Tout dépend de la façon dont notre cerveau fonctionne, poursuit Benois. L’une des nombreuses fonctions de notre système limbique est de stocker nos souvenirs et de nous aider à leur donner un sens. Toutes les agressions raciales dont nous avons été témoins et tous les événements néfastes que nous avons vécus sont stockés en nous. Ces traces auront un effet sur les décisions que nous prendrons et les relations que nous établirons avec autrui. Quand on commence à comprendre comment notre corps fonctionne et influe sur notre ressenti, nos pensées et nos actions, on voit comment certaines pratiques pour prendre soin de soi peuvent entraîner un changement dans les résultats ».
Franklin se fait l’écho de cette idée quand elle explique que chacun d’entre nous peut réévaluer ce que signifie prendre soin de soi individuellement, indépendamment de tout commentaire ou de toute critique sur ce à quoi le militantisme « devrait ressembler » d’un point de vue extérieur.
« Le fait de redéfinir la notion de prendre soin de soi s’inscrit dans le contexte des soins communautaires et vise à se guérir soi-même et à guérir nos communautés Noires. On n’est pas toujours obligé de faire les choses en grande pompe. Des actes de résistance passent inaperçus et sont pourtant essentiels, ajoute-t-elle. Et pour les personnes Noires, la question de prendre soin de soi va bien plus loin que les discussions d’une « journée de détente ». C’est une question d’équilibre entre se mobiliser pour la justice sociale et prendre le temps de se reposer. Nous devons regarder la gestion de notre santé et les soins communautaires sous un nouvel angle et se laisser l’espace pour réimaginer les univers postcoloniaux. En tant que femme Noire, je pense que l’une des choses les plus puissantes que l’on puisse faire est d’apprendre à prendre soin de soi-même et de sa santé mentale, tout en nous soutenant mutuellement et en œuvrant ensemble au changement ».
C’est le conseil que donne Sutherland à la prochaine génération de militantes et de militants ACN, et c’est ce qu’elle met elle-même en pratique : prendre soin de soi et être là pour les autres membres de la communauté ACN. « J’ai l’impression que c’est la meilleure façon pour moi de conserver un équilibre et de m’assurer d’être entourée d’alliés, car je refuse de regarder les choses en pensant que « tout le monde nous déteste ».
J’ai demandé à Sutherland ce qu’elle dirait à l’enseignant qui l’a traitée du « mot en N » si elle pouvait remonter le temps.
« Je dirais, ’’Ce n’est pas bien, mais c’est OK’’, comme dans la célèbre chanson de Whitney [Houston]. À l’époque, je ne savais même pas ce que signifiait ce mot-là. Mais j’ai compris l’intention : me blesser. Pour moi, les mots sont très puissants et je les prends à cœur. »
Noir comme qui? Pourquoi utilisons-nous « ACN » au lieu de « Noir »? de la Commission de la santé mentale du Canada. Photo: Melicia Sutherland. Crédits: Juanita Muwanga
Related Articles
Guérir et entrevoir les possibilités grâce au patin
Ce récit est le dernier de la série consacrée à la santé mentale pendant les fêtes. Si les festivités de fin d’année peuvent être source de joie, en revanche, elles peuvent aussi éveiller des sentiments de stress et de deuil. Lisez tous les articles pour savoir comment d’autres personnes ont réussi à surmonter ces difficultés.
En 1984, j’ai décidé de rechausser les patins.
J’avais déjà patiné dans l’enfance, mais cette fois-ci, ça allait plus loin. C’était devenu une passion, voire une obsession, après de longues années loin de la glace, après avoir abandonné le sport en raison de tout ce qu’il représentait pour un jeune adepte du punk rock, de la politique, de la rébellion et de l’art. Le sport correspondait au statu quo et était réservé aux sportifs. C’était en quelque sorte « l’opium du peuple » et un lieu où les hommes et les femmes – mais surtout les hommes – se comportaient méchamment. Mais le patinage. Le patinage était différent. Le fait de simplement patiner me permettait un retour facile au sport, sans qu’il n’y ait de contact physique violent ou qu’il ne soit question de compétition.
J’ai fait mes débuts sous les lampadaires du parc Valleyfield à Etobicoke – même le nom avait une consonance réconfortante et bucolique malgré les températures inférieures à zéro – pour ensuite m’aventurer sur d’autres patinoires à travers la ville : Weston, Rosedale, Ramsden, Dufferin Grove, Regent Park. Je parcourais les patinoires de la ville, allant même jusqu’à rédiger un article pour le Toronto Star sur la façon dont on pouvait se déplacer d’est en ouest en glissant sur ses surfaces gelées, un peu comme dans le film The Swimmer avec Burt Lancaster, mais en version hivernale. J’ai acheté une paire de patins usagés, puis une autre, et enfin une toute nouvelle paire de Bauer 300, ne manquant pas de me vanter de ce superbe achat à qui voulait bien l’entendre.
Au début, je ne pensais pas que le patinage pouvait raviver autant le moral que le physique. Mon corps se mouvait différemment, et ce, dans des cadres nouveaux. Je combattais le froid et le vent, et je transpirais abondamment en bougeant – un concept inédit pour un être habitué à la relative inertie des redressements assis. Le patinage est un exercice qui consiste à se déplacer constamment, en dévorant chaque centimètre de glace. Je n’étais pas le genre de patineur qui mettait en danger les enfants avec ses triples boucles piqués ou qui engueulait les patineurs plus âgés et plus lents qui se mettaient en travers de sa trajectoire – je me sentais complètement zen et détaché du reste du monde. J’étais libre et heureux, même en avançant à une cadence modérée. J’avais très chaud malgré le vent glacial, je sentais mes jambes agréablement fatiguées après avoir sillonné la glace jusqu’à minuit, moment où quelqu’un sifflait pour indiquer que la barrière se refermait.
Pour moi, le patinage unit l’extase des mouvements fluides et la nostalgie de revisiter l’époque lointaine où mon univers s’est compliqué par la contrainte de choisir entre le sport et la musique. J’ai 59 ans maintenant, mais je retrouve toujours ma jeunesse sur la glace, cherchant toujours à grandir et à m’épanouir davantage. En vérité, il s’agit d’un geste teinté de mélancolie, car si tout s’était bien déroulé jadis, je n’aurais jamais arrêté. Comme j’avais rapidement compris qu’être actif me permettait de garder l’équilibre entre les deux oreilles, le patinage a contribué à enrichir mon imagination et ma mémoire. Pourtant, cette activité n’a pas toujours été synonyme de bonheur de jeunesse ni de jubilation sur l’étang gelé. Elle m’a également replongé au cœur de la période la plus difficile de ma vie.
Lorsque le moment de rédiger un autre livre est survenu en 2013, mon amour de la glace a fait remonter en moi un souvenir de la septième année à l’école Dixon Grove Junior Middle School d’Etobicoke. Cette année-là, j’ai vécu de l’intimidation de la part d’un garçon plus grand et plus costaud que moi, prénommé Roscoe (nom fictif), qui me brutalisait tous les jours après les cours. J’étais beaucoup trop humilié et terrifié pour en parler à qui que ce soit; pourtant, il s’en prenait souvent à moi en pleine cour d’école, à la vue des élèves, du personnel enseignant et des passants. Jamais personne ne s’est arrêté pour se demander pourquoi ce gros gaillard était assis sur son camarade, en train de le frapper derrière la tête. Peut-être que certains d’entre eux ont simplement jugé habituel que des enfants s’amusent de cette façon – cela arrive trop souvent, malheureusement – mais la question à savoir pourquoi aucun enseignant n’est intervenu s’est imposée dans mon esprit, à mesure que je ressassais mes souvenirs. J’ai utilisé tout ce vécu pour m’inspirer dans la rédaction de mon livre Keon and Me, où je raconte l’histoire de cette année-là en alternant les sections : l’une, rédigée à la troisième personne, du point de vue de moi, en tant que gamin de 11 ans, et l’autre, à la première personne, selon ma perspective de quinquagénaire, basé sur le recul que j’ai maintenant. Je suis reconnaissant que le patinage m’ait inspiré cette idée créative, même si elle m’a astreint à revivre le stress, la douleur et la colère qui viennent avec la réminiscence de cette période de ma vie. J’ai tenté de faire œuvre utile en déballant mes souvenirs de cette époque. Toutefois, bien qu’il réveille des vérités crues enfouies le passé, le sentiment de nostalgie nous amène souvent à célébrer ce qu’il y a de meilleur dans la jeunesse, la simplicité et la nouveauté.
Même si le patinage – et le hockey (deux ou trois fois par semaine depuis trente ans) – s’avère une excellente façon de continuer à faire de l’exercice, il s’agit aussi d’un espace où je me rends pour plonger dans mes pensées. Dans un contexte si peu contraignant, bien des gens ont le réflexe de ruminer leurs pensées, mais pour ma part, le fait de bouger et de jouer me fait sentir libre et inspiré. La bouffée d’air frais que me procure le froid d’une patinoire extérieure ou d’un aréna fait en sorte que ma tête se libère et je ne pense à rien d’autre qu’au plaisir de jouer. Les éclairs d’inspiration pour des chansons ou des histoires, des mélodies ou des récits surgissent ainsi lorsque je suis sur la glace ou tout juste à côté, assis sur le banc en attendant mon tour pour jouer ou en train de me préparer pour la mise au jeu. La balle molle, le tennis, le golf, le basket-ball… j’ai pratiqué toutes ces activités. Mais aucune d’entre elles n’a suscité ou fait naître de nouvelles idées comme l’a fait le hockey. Je pense que chaque personne a son propre moteur– qu’il s’agisse de jouer du violoncelle, tricoter, faire du vélo, classer ses albums par ordre alphabétique – et pour moi, c’est ce qui fonctionne le mieux. Je suis très heureux de l’avoir trouvé, et reconnaissant qu’il m’ait trouvé.
Je ne patinerai pas toute ma vie; personne ne le fait. Mais alors que la plupart des gens se désoleront de tourner la dernière page du calendrier en fin d’année – d’autant plus en période de COVID-19, où la noirceur et le froid de l’hiver sont de mauvais augure pour les gens qui doivent éviter les regroupements intérieurs afin d’éviter les risques d’infection – moi, je me réjouirai de l’arrivée du froid, car, à mes yeux, son apparition signifie le retour de la glace et du plaisir de jouer. Le sol va geler et de la fumée s’élèvera au-dessus des cabanes abritant les patineurs.
Et je serai là, en train de patiner.
Comment redonner (ou demander de l’aide) durant la période des fêtes (Commission de la santé mentale du Canada)
Cinq façons de protéger votre santé mentale durant le temps des Fêtes